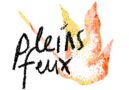Dans le domaine scientifique, la parallaxe désigne le changement qui s’opère dans l’apparence d’un objet quand son observateur modifie sa position. En l’appliquant au théâtre, le metteur en scène Kornél Mundruczó et l’autrice Kata Wéber témoignent d’un phénomène proprement humain : comment le sens d’un même événement évolue en fonction de la perspective et de la situation historique des personnes dont il impacte l’existence. Parallax, présentée au Théâtre de l’Odéon, met ainsi à jour les répliques de l’événement Shoah à travers trois générations d’une famille juive, évoquant également en creux les impasses de la Hongrie contemporaine, par un théâtre vibrant, vivant, et évocateur.
Questions de judéités
La scène se situe dans l’appartement d’Eva Rosenfeld, octogénaire têtue et un peu sénile. Nous ne la voyons que par l’entremise de caméras la filmant en direct sur une musique anxiogène : l’appartement nous est d’abord un espace caché, privé, comme les tourments d’Eva, qui erre et maugrée alors que sa fille Lena arrive. Autant cinéaste que metteur en scène, Kornél Mundruczó se plait à mélanger les media, et l’image filmée présente l’avantage de nous rapprocher du visage ridé de Lili Monori, comédienne exceptionnelle à l’intensité retenue, dont les gestes et les mots sont habités. Interprétée quant à elle par Emőke Kiss-Végh, Lena, la quarantaine inquiète, vient chercher sa mère pour l’accompagner à une cérémonie : la vieille dame doit recevoir des mains du gouvernement une médaille de rescapée des camps de concentration.
Parallax nous plonge ainsi d’emblée dans un enjeu actuel, et dessine son ambition dramaturgique : explorer la façon dont la mémoire et le traumatisme, pris dans des rapports sociaux, façonnent l’identité.
Par son refus obstiné, et les paroles qu’elle lâche (« honte », « complices »), on saisit que la proposition indigne Eva – rien d’étonnant quand on sait l’entreprise éhontée de réécriture de la mémoire hongroise de la Shoah par le pouvoir d’extrême-droite de Viktor Orban, visant à effacer le rôle du gouvernement de l’époque dans la déportation et à redéfinir l’image de la Hongrie comme uniquement victime de l’Allemagne nazie. Sans l’expliciter, Parallax nous plonge ainsi d’emblée dans un enjeu actuel, et dessine son ambition dramaturgique : explorer la façon dont la mémoire et le traumatisme, pris dans des rapports sociaux, façonnent l’identité.
Car le dialogue qui s’engage entre la mère et la fille révèle les forces contradictoires qui les animent. Si d’un côté Eva tient à ne pas exhiber son identité juive, la discrétion étant gage de survie, Lena quant à elle cherche à en donner la preuve auprès de la communauté juive allemande : émigrée à Berlin, elle espère ainsi inscrire son fils Jonas dans une meilleure école. Elle cherche un acte de naissance authentique parmi cinq documents faux – façon de montrer par le concret comment l’identité est une construction, a fortiori en temps de crise. Les positions sont plus complexes qu’il n’y paraît, Lena reprochant à sa mère d’avoir organisée son enfance autour de l’Holocauste, tandis qu’on découvre qu’Eva elle-même est née à Auschwitz.
Cette révélation sidérante, qui s’accompagne d’un macabre récit autour de la figure de Mengele, et fait d’Eva une figure traumatique dans son existence même, ne semble pour les deux femmes qu’être une histoire ressassée parmi d’autres, marque de la prégnance du témoignage dans leur quotidien. Cette longue discussion ancre les deux femmes dans un rapport mère-fille conflictuel assez univoque. La distance créée par la caméra et la dimension particulièrement explicite du dialogue sur l’objet du conflit, sans zones d’ombre, finissent par ennuyer et nous rendre malheureusement trop passifs dans la réception, en dépit, ou peut-être à cause de son contenu narratif riche.

Un appartement palimpseste
Mais l’ouverture du quatrième mur littéral sur l’appartement, coïncide avec un événement d’une époustouflante puissance visuelle : laissée seule dans le salon, cherchant de l’eau au robinet pour nettoyer les dégâts de sa mère incontinente, Lena se retrouve littéralement submergée par des trombes d’eau déboulant dans l’appartement par toutes ses ouvertures : fenêtres, placard de la cuisine, et même le frigo. De véritables cascades qui ensevelissent le vieux salon dans une image radicale de déluge biblique et de catastrophe destructrice. Les objets volent hors des placards, les meubles anciens sont détrempés… La pièce quitte alors momentanément le réalisme cinématographique de sa première scène pour une séquence surréaliste et symbolique démente, et théâtralement extrêmement impressionnante. Passé son choc initial (partagé par le public), Lena finit par accepter l’inondation, et se déshabille sous les chutes dans un geste qui exprime une forme de libération, de soulagement : heureuse au milieu du désastre, le personnage se teinte d’une dimension héroïque.
Idée brillante que cette unité de lieu : l’appartement devient pour nous la surface de projection sur laquelle se fixent en strates les expériences d’Eva, de Jonas et de Lena
Quand, des années plus tard, Jonas débarque dans l’appartement de sa grand-mère à la veille de son enterrement, c’est donc dans une pièce encore trempée qu’il arrive. Signe que les catastrophe du passé continuent d’imprégner ce lieu où sa mère n’a jamais voulu l’emmener. Jonas est éloigné des conflits de Lena et d’Eva – il saisit l’opportunité de ce passage à Budapest pour inviter à la maison un groupe d’amis homos qui transforment rapidement le salon en lieu d’une orgie gay, poppers, coke et godemichés inclus. Tous à poil sur de la musique techno, les cinq hommes (dont le metteur en scène lui-même) forment une nouvelle image loufoque et perturbante tant elle est en décalage avec celle de la vie d’Eva à laquelle elle vient se sur-imprimer. Idée brillante que celle de cette unité de lieu : l’appartement devient pour nous la surface de projection sur laquelle se fixent en strates les expériences d’Eva, de Jonas et de Lena, chaque nouvelle scène donnant une nouvelle perspective sur les échos du traumatisme.
Résonances du traumatisme
Représentant d’une nouvelle génération, Jonas est moins ancré dans une identité fixe que ses parents : de sa judéité, il n’a que faire ; hongrois, il ne l’est pas vraiment, butant sur les mots et se faisant reprendre par ses camarades d’orgie ; refusant même l’étiquette de gay, ne la trouvant pas assez progressiste. « Ni juif, ni gay, ni hongrois : berlinois ! » l’exprime ironiquement un de ses compagnon de soirée. Une identité fluide, définie par la négative, pour ce garçon touchant, interprété en alternance par Bence Mezei et Csaba Molnár, qui cache son mal-être contemporain, la solitude, derrière la fête et la drogue. Sans qu’on s’en aperçoive, l’orgie s’est transformée en débat politique, qui rôdait là dans une simple dispute de couple : à nouveau c’est un enjeu actuel, la situation des LGBTQIA+ en Hongrie, qui fait surface, quand s’opposent Jonas, Mark, l’homo qui s’assume, et son partenaire Laci, membre du gouvernement conservateur qui cache son homosexualité et assume ses discours nationalistes. Une nouvelle fois, Parallax réussit à nouer ses enjeux intimes et politiques – l’oppression à la croisée de l’historique et du contemporain – au sein d’une écriture scénique réaliste et vivante.

La séquence finale, le lendemain de la fête, achève de boucler le lien entre les générations, quand Lena retrouve Jonas pour aller aux obsèques. Plutôt que suivre la ligne droite attendue de la transmission générationnelle, la pièce saute ainsi une génération pour y revenir finalement, dans un mouvement circulaire. Les retrouvailles de la mère et du fils dans l’appartement d’Eva, sont violentes avant d’être tendres, illustrant à nouveau la difficulté de partager son vécu avec l’autre pris dans une situation différente. Moins bavarde que dans sa première séquence, la pièce travaille plus souterrainement, parsemant le dialogue d’images topiques de l’Holocauste, moins explicites et plus lointaines que le récit d’Eva, mais pas moins signifiantes. Il en est ainsi d’un échange apparemment anodin où Jonas et Lena réalisent avoir chacun·e oublié leur paire de chaussures pour l’enterrement… faisant douloureusement écho aux Chaussures au bord du Danube, le monument budapestois en hommage aux victimes de la Shoah. L’événement initial continue ainsi de lier entre eux et malgré eux les différents protagonistes, et l’image final les réunit tous·tes, par delà les époques et les identités dans un même tableau chorégraphique, soulignant leur traversée d’une situation historique commune.
Après Living the dream with grandma, c’est la deuxième pièce hongroise présentée à Paris en quelques mois que nous voyons et qui se saisit de la question de la mémoire de la Shoah et de ses survivantes. Si la première faisait le choix d’une forme documentaire et fragmentaire pour aborder le sujet, Parallax déploie quant à elle sa fiction transgénérationnelle et politique avec une formidable précision. D’une théâtralité très maîtrisée, le texte de Kata Wéber, la mise en scène de Kornél Mundruczó et l’interprétation du Proton Theatre, convergent pour faire de Parallax une œuvre profonde sur la Hongrie contemporaine – rendant d’autant plus regrettable que ses thèmes l’empêchent d’y être représentée.
Parallax
texte – Kata Wéber
mise en scène – Kornél Mundruczó / Proton Theatre
avec – Soma Boronkay, Emőke Kiss-Végh, Erik Major, Bence Mezei, Csaba Molnár, Lili Monori, Roland Rába, Sándor Zsótér
dramaturgie – Soma Boronkay, Stefanie Carp
scénographie – Monika Pormale
costumes – Melinda Domán
lumière – András Éltető
musique – Asher Goldschmidt
chorégraphie – Csaba Molnár
collaboration artistique – Dóra Büki
assistant à la mise en scène – Soma Boronkay
du 10 au 18 octobre à l’Odéon – Théâtre de l’Europe dans le cadre du Festival d’Automne à Paris