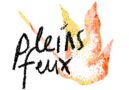En ouverture du Festival d’Avignon 2024, la metteuse en scène, performeuse et dramaturge espagnole Angelica Liddell présente DÄMON, El funeral de Bergman. Un spectacle qui convoque les fantômes du réalisateur suédois et les démons du Palais des Papes dans une cérémonie vibrante pour vaincre la violence, la solitude et la mort, non sans polémique.
Rude tâche que celle d’écrire une critique sur la dernière création d’Angelica Liddell, DÄMON, El funeral de Bergman, événement de cette 78ème édition du Festival d’Avignon présenté en Cour d’Honneur du Palais des Papes. Pas seulement parce que le spectacle, dense et complexe, mêle théâtre, performance et danse, et charrie, deux heures durant, de nombreuses couches textuelles et dramaturgiques dans une proposition allègrement foisonnante. Mais aussi et surtout car le rapport de l’artiste à ses critiques en constitue l’une des dimensions les plus évidentes.
La critique est aisée, mais l’art… ?
Avec toujours un temps d’avance sur ses contempteurs comme sur ses fans, Angelica Liddell ouvre en effet sa pièce par une lecture d’extraits les plus incisifs de critiques français à l’encontre de son œuvre – notamment de Liebestod, son dernier spectacle présenté au Festival. Dos au public, seule dans l’immensité de la Cour d’Honneur, elle crie au mur du Palais des Papes ces mots parfois teintés de mépris, où la recherche de la formule choc pour accabler l’artiste prend souvent le pas sur l’analyse réfléchie. Ainsi réappropriée par la performeuse, ces phrases paraissent tout d’un coup bien mesquines, semblant n’avoir été écrites que pour procurer à leurs auteur·ices un sentiment de pouvoir et de supériorité sur l’œuvre. Et Angelica d’appeler, après chaque extrait, le ou la critique par son prénom : « Armelle ? Armelle où es-tu ? », voire de les insulter. Si certain·es des cité·es étaient sans doute parmi les 1947 spectacteur·ices de la Cour d’Honneur, ils et elles n’ont pas souhaité se manifester et sont restés bien silencieux·ses.
Ce faisant, elle se revendique d’Ingmar Bergman avec qui elle dialoguera, figurativement et littéralement, durant toute la pièce. Le réalisateur et metteur en scène suédois avait en effet écrit dans ses Carnets cette phrase que Liddell cite en exergue :
Ma pièce s’ouvre avec un acteur qui descend dans le public, étrangle un critique, puis lit à voix haute dans un petit carnet noir toutes les humiliations qu’il y a notées. Il vomit ensuite sur le public, puis sort de scène et se tire une balle dans la tête.
Face aux critiques, Angelica Liddell réaffirme la puissance d’une parole qu’un corps porte seul devant des milliers de spectateurs, à la merci du jugement public.
Cette ouverture n’a pas manqué de faire réagir une profession qui s’est sentie attaquée (voir par exemple Libération, Le Figaro, sceneweb – et avec un peu de recul dans Télérama), mais force est de constater qu’Angelica Liddell opère ainsi un retournement fabuleux qui a le mérite de révéler les postures. A la question : « qui prend le plus de risques ? », elle répond bien évidemment l’artiste. Et face aux critiques qui lui reprochent d’être devenue une artiste officielle, bien à l’abri dans les théâtres nationaux, elle réaffirme la puissance d’une parole qu’un corps porte seul devant des milliers de spectateurs, à la merci du jugement public – ce que les artistes ont toujours été et seront toujours – tandis que ses détracteurs demeurent assis dans l’ombre, protégés également par la réputation respectable des journaux pour lesquels ils écrivent.
Il ne s’agit donc pas, ne leur en déplaise, d’opposer liberté de création artistique et liberté de la presse (certain·es s’empressant de crier à la dictature), mais bien de refaire entendre avec fracas qu’entre l’artiste et ses critiques, le rapport de force se situera toujours en faveur des seconds, quand les premiers se mettent à nus (littéralement, dans le cas d’Angelica Liddell).
De la provocation, à la parodie, à la désillusion

À l’impression qu’Angelica Liddell demeure une metteuse en scène provocante et provocatrice – ce qu’elle a sans doute été – ce spectacle est également une mise au point. Car, si dans ce prologue elle propose une de ces scènes dont elle seule aurait pu avoir l’idée – se laver le sexe à vue et balancer l’eau sur le mur du Palais, rejetant ainsi à la fois l’idée d’une culture patrimonialisée et toute forme de déférence à l’égard de cette scène historique – le choc n’est plus la stratégie première de la performeuse. (Sinon, peut-être, à l’égard des critiques professionnels qu’elle réussit à ébranler en leur renvoyant leur propres mots.) En effet, le long monologue rageur caractéristique de ses spectacles, introduit ici par la citation « Puis, elle vomit sur le public », prend des allures d’auto-parodie, puisque les critiques rapportées au préalable en ont déjà affaibli la charge. Angelica Liddell semble se livrer à un exercice de son propre style, sur le mode du : « vous n’en pouvez plus ? Vous en aurez encore ! » Et pourtant, malgré cela, malgré l’auto-dérision et l’évidente exagération absurde de certains passages (« y a-t-il quelque chose de plus important qu’une érection ? »), certaines paroles touchent encore.
Au cœur de cette tirade liddellienne émerge ainsi le constat désabusé de l’impossibilité de l’amour quand tous les rapports humains sont régis par la solitude et la violence, par le désir de « s’entretuer, de se déchirer, de se trahir ». « Triste destin que celui des gens » répète-t-elle à l’envi, citant Le Songe de Strindberg (dont la scène sera rejouée plus tard), et de s’adresser au public : « Ce n’est pas de l’ennui, vous êtes justes impatients de vous étriper ! ». Une noirceur qui, venant de la performeuse espagnole, n’est pas surprenante, mais qui prend des échos tragiques à l’heure où la violence du fascisme refait surface. Une situation à laquelle elle n’hésite pas à faire référence, non superficiellement, mais pour poser les questions essentielles (voulons-nous des vrais artistes ou du patrimoine), et illustrer par l’action tout ce que nous, et elle en tant que femme et artiste, risquons de perdre de liberté de parole et de création si une idéologie mortifère venait au pouvoir.
Par sa performance vocale et physique, courbée en deux quasi-nue à vomir ou débiter sans s’interrompre de sa voix rocailleuse ce monologue, Angelica Liddell impressionne, et fait trembler les murs du Palais des papes et toute la cité avec. Quand elle s’interrompt finalement pour s’adosser au mur et boire quelques gorgées d’eau dans son déshabillé entièrement blanc, sa présence continue d’irradier la scène rouge.

Carnaval d’infirmes et de démons
Avec ces flots de paroles, on en oublierait presque qu’Angelica Liddell est aussi une formidable créatrice d’images, et DÄMON, El funeral de Bergman n’y fait pas exception, en mêlant le grandiose et le trivial, le sacré et le viscéral. Il y a ainsi ce plateau entièrement rouge sang, où comme seuls éléments de décors sont placés un urinoir, une cuvette de toilettes et un bidet. Cette couche écarlate, qu’un pape vient silencieusement parcourir, apparaît comme la mare de sang du massacre de la Glacière – cet épisode de la Révolution Française qui transforma le palais des Papes en bain de sang, y compris celui d’innocent·es et de femmes enceintes. S’inscrivant ainsi dans la longue histoire du bâtiment comme peu d’autres spectacles, DÄMON en investit puissamment l’architecture : en faisant apparaître des fantomes et des ombres à toutes les fenêtres de sa façade, des hommes-araignées descendant du rempart le long du mur, ou encore cinq jeunes femmes en robe blanche prêtes à sauter des fenêtres du portail monumental, sous la rosace qui surplombe la scène à cour.
Animé ainsi, le plateau ressemble à un rituel entre le sacré et le satanique, où l’on expie la peur et le dégoût pour retrouver du commun.
Toutes ces visions se fondent dans une deuxième partie qui prend des allures de carnaval d’enfer, où les tourments d’Angelica Liddell prennent corps. Ainsi, la douzaine de vieillard·es en fauteuils roulants tourmentés par les corps de jeunes femmes font écho à la peur de la décrépitude exprimée par la metteuse en scène. Autour d’eux, employés de la morgue, acteurs et actrices entièrement rouge tels des diables, pape en fauteuil roulant, et autres apparitions créent ainsi un chœur étrange et grotesque, tantôt effrayant, tantôt drôle. Un enfant, les yeux bandés, et une vieille femme qui se réveille sur son lit de mort, semblent, en entourant Angelica, représenter les trois âges de la vie. Animé ainsi, le plateau ressemble alors à un rituel entre le sacré et le satanique, où l’on expie la peur et le dégoût pour retrouver du commun : jeunes et vieux font une ronde autour des fauteuils et les vieillard·es s’avancent bras ouverts vers le public comme pour nous suggérer d’embrasser notre propre vieillesse.
La joie contre la mort
Ce rituel pour contrer la haine, la violence et la mort, se prolonge dans la dernière partie du spectacle, dans laquelle Angelica Liddell met en scène l’enterrement d’Ingmar Bergman, que lui-même aurait scénarisé, le voulant à l’image de celui du pape Jean-Paul II. Dans un ultime pied-de-nez, nous n’entendrons de cette cérémonie ni les prières, ni les chants, puisqu’ils sont recouverts par des bruits d’alarme et d’hélicoptère. Loin d’être une nouvelle provocation, cet assourdissement a le pouvoir de nous faire entendre que la beauté et l’art se construisent ici (et peut-être toujours) en opposition aux forces de la destruction, qui menacent sans cesse de les recouvrir, et qu’un effort collectif est nécessaire pour les faire exister et perdurer.
Après cette cérémonie perturbée, Angelica demeure seule avec Bergman, dans son cercueil en bois qui occupe le centre de la scène. C’est dans ce dialogue final, loin du bruit et de la fureur du début de spectacle, que la parole se teinte de sincérité et d’émotion. À cet alter-ego dont elle partage les mêmes préoccupations, l’actrice, metteuse en scène, performeuse, autrice, se livre, confiant sa peur de la mort, et la souffrance d’être constamment soumise à un jugement meurtrier : « Je regarde toujours vers quelqu’un qui me juge. (…) Et tout ce mépris juste pour faire du théâtre ? » Son discours douloureux prend des accents tchekhoviens : « Demain, nous nous remettrons au travail, tant nous avons peur. (…) Il faut travailler. » Puis, bouleversée et bouleversante, c’est vers la joie qu’elle se tourne, l’allegresse comme dernière sauveuse, donnant sens à son spectacle entier : convoquer ensemble les paroles de ses détracteurs, les fantômes de ses propres angoisses, et les images de la violence du monde, et les lier dans un rituel fou, sacré, et libérateur, profondément théâtral, pour que de la souffrance triomphe la joie. Et quel bonheur, au moment des saluts, de la voir danser, applaudir et sourir en communion avec les centaines de spectacteur·ices de la Cour d’Honneur.

DÄMON, El funeral de Bergman
Texte, mise en scène, scénographie et costumes – Angelica Liddell
Du 29 juin au 5 juillet, Cour d’Honneur du Palais des Papes, Festival d’Avignon
Spectacle vu le 29 juin au Festival d’Avignon
Prochaines dates :
19 au 21 juillet – Grec Festival de Barcelona
13 au 21 septembre – Teatros del Canal, Madrid
26 septembre – 6 octobre – Odéon-Théâtre de l’Europe, Paris