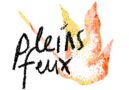Sur le grand plateau du Théâtre Silvia Monfort, Juglair pose sa petite scène en bois, ses barres de pole dance et de mât chinois, et nous offre un numéro d’une infinie beauté. Virevoltant avec autant d’adresse physique que de sens du verbe entre les frontières des genres, l’artiste invente un espace remède, nappé d’autant d’intime que de force politique, et fait de Dicklove un spectacle réjouissant entre cirque et cabaret.
Je suis quoi ?
Dicklove, c’est le récit d’une petite fille qui n’ose pas courir plus vite que les garçons et qui ralentit avant la ligne d’arrivée, pour ne pas les vexer. Mais qui, malgré son sacrifice, n’échappe pas aux moqueries : trop musclée, trop grande et trop rapide, elle est soit « tarée » soit « garçon manqué ». Juglair devient justicière : dans la cour de l’école, les autres filles l’appellent à l’aide quand les garçons soulèvent leurs jupes. Très tôt donc, elle court, entre les filles et les garçons, protège les unes et fait fuir les autres, avec ses souliers vernis et sa robe à fleurs. Plus tard, sa musculature se dessine davantage – elle a choisi le mât chinois, un agrès encore aujourd’hui peu féminin – et son corps interpelle, déborde, transgresse. Les autres la prennent pour un homme.
On a du mal à la croire, au début, avec sa voix douce, assise, discrète, au milieu du public. Puis le jeu commence, elle nous montre : ses omoplates, ses jambes, ses bras. L’effet est là, impossible de ne pas laisser notre imaginaire projeter une forme d’impossible : à la fois féminine, masculine, Sandrine. Même son visage semble se transformer, se durcir. Juglair, fière et digne, se joue de notre regard, et nous offre une série de personnages inquiétants, tendres et clownesques, du mâle alpha à la drag-queen/king monstrueux·se, lui permettant de dresser un portrait plus que multiple d’elle-même.

Double standard
Volant de la barre de pole dance au mât chinois, Juglair s’amuse des attentes associées à ces deux disciplines : la féminité et la sensualité pour l’une, la puissance virile pour l’autre.
La simplicité de la scénographie ne fait que renforcer l’intensité de la démonstration : deux barres sont dressées, l’une blanche et l’autre noire, respectivement associées aux disciplines de la pole-dance et du mât chinois. Volant de l’une à l’autre avec une aisance spectaculaire, Juglair s’amuse des attentes associées à ces deux disciplines : la féminité et la sensualité pour l’une, la puissance virile pour l’autre. Pourtant, la précision technique qu’elle déploie est bien la même, et les figures acrobatiques qu’elle enchaîne à quelques mètres de nous laissent bouche-bée. Là encore, tout n’est qu’une question d’angle : que projetons-nous sur une simple barre métallique ? Qu’est-ce que cela vient rassurer, confirmer en nous ?
Loin de se limiter à cette seule expérience, Juglair traverse toute une série de codes et de genres : ceux du féminin et du masculin bien sûr, mais aussi les genres artistiques ; le cirque agissant comme porte d’entrée vers le clown, le drag-queen/king et le cabaret. Des espaces esthétiques où « le ridicule côtoie le grandiose », où la binarité est fertile et transgressive. Et pas de cabaret sans musique : Juglair et son acolyte multi-instrumentiste Lucas Barbier chantent et enchantent ce rituel libérateur, à coup de rythmes électros, solos endiablés, reprises parodiques et lip-sync jubilatoire.
« Je suis un monstre qui vous parle »
La poésie et l’émotion trouvent aussi leur place, se faufilant subtilement dans les interstices de la fête : dans une scène qui prend au cœur, Lucas Barbier chante la petite fille aux souliers vernis tandis que Juglair se farde devant nous des couleurs du clown, nous prenant pour miroirs. Car le masque a ici mille symboles : celui du genre bien sûr, et des étiquettes binaires que l’on colle aux caractéristiques physiques d’un être humain. Il y a aussi le masque de l’artiste, qui se met à nu pour ne plus être moqué, qui se raconte pour éviter que l’on raconte à sa place. Le masque du monstre enfin, ou plutôt de celui qui est fait monstre, par celles et ceux qui ne veulent pas écouter. Car le propre du monstre est d’être ostracisé, et donc silencieux. Ici, le monstre de Juglair se défait littéralement du film plastique qui entrave sa bouche et nous parle, chante, rit et existe.
Ni roi ni reine, Juglair est pure majesté.
Il faut saluer la grande beauté des costumes (signés Léa Gadbois-Lamer), dernière métamorphose de la chrysalide Juglair, où cuir et fourrure côtoient plastique et paillettes. Féminine, masculine, fauve, extraterrestre, Juglair a finalement tout d’elle-même et peut-être même plus encore. Une dernière fois, elle brille de ses mille feux pluriels, avant de se rassoir avec nous, entière et libre, nous quittant aussi tendrement qu’elle nous est arrivée. Ni roi ni reine, Juglair est pure majesté.
Dicklove
Création et interprétation – Juglair
Création et interprétation sonore – Lucas Barbier
Regards extérieurs et dramaturgiques – Claire Dosso et Aurélie Ruby
Création lumière – Julie Méreau
Régie lumière – Julie Méreau ou Marie Roussel (en alternance)
Construction – Max Heraud, Etienne Charles et La Martofacture
Costumes – Léa Gadbois-Lamer
Jusqu’au 12 octobre 2024 au Théâtre Silvia Monfort.