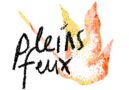Portée par l’association Territoires de Cirque, la Nuit du Cirque a fêté cette année sa 7ème édition, avec une programmation toujours aussi riche et éclectique : des créations, des grands spectacles et des plus petites formes, des présentations d’écoles, des ateliers de pratique… Artistes, amateur·rices et amoureux·ses du cirque se sont réuni·es en France et à l’international du 14 au 16 novembre pour célébrer cet art en mouvement.
Direction Lille et l’accueillante maison du Prato – Pôle National Cirque pour découvrir Le repos du guerrier et Nous on n’a rien vu venir, les deux propositions uniques du comédien, acrobate et lanceur de couteaux Édouard Peurichard (cie La Supérette). Deux spectacles qui ouvrent chacun à leur manière des champs de réflexion philosophique inattendus, sur fond de bidouilles vidéo et de nécessité de faire archive en commun.
Le repos du guerrier
L’art du désordre
Édouard Peurichard est un maître des temps morts, des erreurs volontaires et du désordre mis en scène : tout est savamment orchestré pour nous donner l’illusion d’une discordance entre lui et le monde.
Lauréat du dispositif Circusnext en 2023, ce spectacle, qui n’en est pas vraiment un, est une pépite d’originalité et d’humilité. Au plateau, tout est à vue : une table sommaire, un tapis enroulé, des objets posés par terre… Comme au milieu d’une répétition, à laquelle Édouard Peurichard nous invite, tout sourire et en chanson. Il repart avec nous sur les traces de son parcours d’artiste de cirque, en nous présentant les moments marquants de sa carrière. Des artistes qui l’ont marqué jusqu’à la construction de son premier numéro acrobatique, en passant par ses élèves de cirques amateur, Édouard Peurichard nous décrit à peu près tout ce qui lui passe par la tête, dans un format plus proche du stand-up que de la démonstration de virtuosité.
Avec malice et ironie, l’acrobate nous explique tout ce qu’il fait et surtout tout ce qu’il ne fait pas : la préparation d’une figure est trois fois plus longue que sa réalisation, la fin du numéro s’élude d’un revers de main, les halètements de fatigue sont décuplés dans le micro de fortune de son téléphone scotché sur sa joue… Une anti-performance bien plus jouissive et identificatoire qu’une exécution parfaite de mouvements appris en école de cirque. Édouard Peurichard est un maître des temps morts, des erreurs volontaires et du désordre mis en scène : tout est savamment orchestré pour nous donner l’illusion d’une discordance entre lui et le monde.

Co-construction du risque
Mais tout l’enjeu de cette entreprise du chaos repose sur le lien inédit et prodigieux qu’Édouard Peurichard parvient à créer avec le public. Avant que le spectacle ne commence, on nous avait prévenu·es : à un certain moment, quelqu’un, dans la salle, se sentira mû vers la scène, et devra suivre cet élan. Par de drôles de pirouettes digitales, l’acrobate arrive à ses fins : il est rejoint sur scène par un·e spectateur·rice non-complice, qui se prête au jeu du partage de risques. Car c’est là qu’Édouard Peurichard tisse son propos : faire de chaque représentation une séance complètement unique, puisque co-construite avec un·e membre du public.

Ce duo sensible joue pour nous la partition des inconnu·es qui s’apprivoisent, et c’est formidablement sensible. Grâce à des exercices de « confiance », parsemés de son humour imperturbable, Édouard Peurichard parvient à accompagner les premiers pas (au sens littéral) de ces amateur·rices circassien·nes qui le rejoignent à chaque représentation, comme il le fait en dehors des plateaux dans le cadre de ses ateliers de cirque adapté (pratique inclusive d’enseignement du cirque, destinée à tous les types de publics). Les fugues de Bach et la voix de Dalida accompagnent ce jeu d’hésitations, de temps suspendus, de rires nerveux, pour poser la question fatale : « comment se rapprocher du risque, sans le prendre ? » Par une habile maîtrise du vrai et du faux, Édouard Peurichard présente la discipline du lancer de couteaux sous un nouveau jour. On reste bouche-bée devant l’ingéniosité des timings et la précision des fausses dissonances.
Un solo peuplé
Le repos du guerrier, c’est un seul-en-scène choral, qui rend hommage avec tendresse à tous·tes celles et ceux qui ont participé à sa création. Chaque membre de l’équipe artistique est soigneusement cité, à travers d’astucieux génériques et par le biais d’anecdotes disséminées tout au long du spectacle. Ses multiples sources d’inspirations, de Bruce Springsteen à Gena Rowlands en passant par le danseur Miguel Gutierrez, mais aussi Xavier et Françoise (ses élèves de cirque adapté) ainsi que le public vivant et aléatoire avec qui il dialogue tous les soirs, sont mises à égalité comme le patrimoine sensible qui a construit son parcours d’artiste. Tous ces portraits délicats ne sont pas relégués au rang des remerciements de bas de page : ils sont la matière dramaturgique de son univers circassien.
Ce clown de ferraille tente l’impossible, et nous donne une leçon d’humilité par cet éloge du décalage et de l’inadaptabilité.
Et, face à eux et elles, le chevalier Peurichard met genou à terre : vêtu de sa lourde armure intégrale, il enchaîne difficilement les postures de yoga (dont celle du fameux guerrier), suivant religieusement l’exemple donné par le tuto Youtube que nous regardons avec lui. Aux clinquements métalliques des couteaux répondent ceux de son étrange appareil : ce clown de ferraille tente l’impossible, et nous donne une leçon d’humilité par cet éloge du décalage et de l’inadaptabilité.
Dans ce spectacle, Édouard Peurichard fait un pas de côté et se défait de toute attente performative : il écrit avec et pour le public. Il s’empare ainsi de toute une autre dimension de sa discipline : le cirque, sans le risque. Loin de le diminuer, cette absence l’augmente sensiblement.
Nous on a rien vu venir
Archivistes conteurs
Dans le prolongement de son premier spectacle, cette nouvelle création d’Édouard Peurichard (construite en collaboration avec le chercheur-jongleur Thomas Martin, et conçue dans le cadre du Cirque Portatif, un ensemble de spectacles pour espaces non-dédiés portés par La Verrerie d’Alès) se propose une fois encore d’archiver les traces du passé. Mais cette fois, ce n’est plus seulement de ses références et inspirations personnelles dont il s’agit, mais de celles de toute l’humanité. Vaste programme porté par ces deux clowns sur fond vert, qui rivalisent d’ingéniosité pour retraverser le socle commun de nos imaginaires de ce dernier quart de siècle.
Ce qui commence comme une fausse conférence participative se révèle vite être une épopée facétieuse et absurde à travers les méandres d’Internet et l’imaginaire collectif.
Nous on n’a rien vu venir s’articule comme un voyage dans le temps, porté par deux amis, Édouard et Marty (le bien nommé), qui tentent par tous les moyens de comprendre ce qui définit notre humanité, notre intelligence, notre rapport aux images et aux technologies… Ce qui commence comme une fausse conférence participative se révèle vite être une épopée facétieuse et absurde à travers les méandres d’Internet et l’imaginaire collectif. Pour leurs démonstrations scientifico-clownesques, ils ont à leur disposition : des pistolets en plastiques, un reenactment de partie d’échec, des sources fausses assumées, des anecdotes personnelles, des méditations guidées, des dauphins et des Fiat Punto. De toutes ces hypothèses pseudo-mathématiques, pourtant, Édouard et Marty parviennent à tirer du sens et à nous plonger au cœur de l’analyse des neurosciences et de la psychologie des usages numériques.

Mises en pièces
En quoi ça consiste, de vivre dans un monde où la population mondiale a plus largement accès à Internet qu’à l’eau potable ? Le point de départ du projet, pour Édouard Peurichard, c’est cette surprésence d’Internet dans notre quotidien, cette « absence addictive » qui saisit lorsque l’on scrolle sans but sur son téléphone, par habitude musculaire. Qu’est-ce qu’on y voit vraiment, dans ces écrans ? Et qu’est-ce qu’on y cherche, dans cette semi-solitude ? Le spectacle recrée devant nous un mini studio vidéo qui nous permet de plonger dans les abysses des images, grâce à un large fond peint permettant aux deux artistes de s’incruster dans les images projetées. Par des démonstrations on ne peut plus simples et désopilantes, Édouard et Marty manipulent avec malice la vérité, comme avec ce ballon de foot truqué devenu l’agrès de figures impossibles.

Les deux escamoteurs jouent avec le hors-champ (dans un sens tout à fait littéral, grâce à ce carré de gazon dans lequel ils se sont téléportés), la perception du réel, le rapport entre acte et parole… Toujours par le prisme d’un humour infaillible et du rapport sensible et égal au public. Dans une scène jubilatoire, Édouard et Marty vont jusqu’à briser la frontière numérique, en interagissant avec espièglerie dans tout un tas de célèbres vidéos d’Internet (chutes, accidents de voiture, réactions en chaînes, et autres « fails » qui ont diverti les réseaux sociaux pendant plusieurs décennies). Au-delà d’une prouesse technique de synchronisation, se révèle toute une dramaturgie du montage et des associations significatives entre certaines images. On y décèle une grande tendresse aussi : on replonge avec surprise dans des dizaines d’années d’archives visuelles qui ont marqué la présence indélébile d’Internet et de ses codes dans notre quotidien.
Attention à l’attention
Les acrobaties ne sont pas en reste dans cet étrange spectacle de cirque philosophico-numérique. Poursuivant leur odyssée, les deux voyageurs du temps chevauchent leur vélo et s’adonnent à tout un tas d’agencements acrobatiques pour tenir à deux, en équilibre. Sur fond de route déserte de jeu vidéo, leurs réflexions se poursuivent, et les improbables associations aussi : qu’est-ce que Fellini aurait pensé des casques VR ? Et si Bip Bip et Coyote étaient une métaphore de la caverne de Platon ? Ces pérégrinations les mènent jusqu’à des futurs indéterminés, par-delà les frontières de la Terre, au milieu des extraterrestres et des paysages post-apocalyptiques générés par intelligence artificielle, dont on rit du style si factice et reconnaissable. Par le truchement du fond vert, Marty finit même par réaliser son rêve : être un astronaute, et vivre des instants de dégravitation grâce Édouard qui se dévoue pour être le porteur invisible, avec sa combinaison intégrale qui le fait disparaître à l’écran.
Au jeu de l’attention médiatique, les zouaves bavards gagnent toujours face aux habiles silencieux.
Là encore, Édouard Peurichard pousse sa réflexion entamée avec Le repos du guerrier sur « l’anti-performance » de cirque : tous les trucages sont à vue, on est à des années lumières d’une démonstration volontaire de virtuosité. C’est pourtant pile à cet endroit que l’enjeu du cirque et du spectacle vivant nous parvient avec force, dans cette observation sur nos attentes de spectateur·rices vis-à-vis des artistes-amuseurs. Dans Nous on n’a rien vu venir, c’est même poussé vers une forme de sadisme : alors que Marty nous présente, humble et silencieux, son numéro de jonglage sur une chanson des Bee Gees, Édouard joue au perturbateur en faisant des grimaces à la caméra, et attire toute l’attention sur lui. La beauté du jonglage de l’un s’efface, parce qu’on rit des bêtises de l’autre. La « cruauté » humoristique de la scène résonne au-delà du simple enjeu d’une représentation, et porte par-là une forte dimension politique : au jeu de l’attention médiatique, les zouaves bavards gagnent toujours face aux habiles silencieux.
Par le biais de références collectives hyper accessibles et d’un langage personnel à l’opposé d’un élitisme universitaire, Édouard Peurichard et Thomas Martin créent, avec Nous on n’a rien vu venir, une formidable plongée philosophique et sociale dans le patrimoine mémoriel des « années Internet », dont on sent presque déjà la vétusté à l’ère de l’intelligence artificielle et de la possibilité – plus seulement humoristique – de plonger dans les images et de combiner le vrai et le faux. Ils y explorent de multiples et fertiles champs de réflexion avec une humilité singulière et la construction d’un lien de confiance absolu avec le public.
Le repos du guerrier
Conception et jeu : Édouard Peurichard – La Supérette
Accompagnement à la mise en scène : Christian Coumin
Création lumière : Manolie Fontanière
Régie générale : Julie Malka
Ingéniosité / entraide : Yoan Richard
Production : La Supérette
Prochaines dates
11 décembre : Théâtre de Pézenas
Du 4 au 6 mars : La Faïencerie (La Tronche)
12 et 13 mars : La Centrifugeuse (Pau)
31 mars : MA Scène Nationale (Montbéliard)
Nous on a rien vu venir
Conception et réalisation : Édouard Peurichard & Thomas Martin – La Supérette
Mise en scène et idée originale : Édouard Peurichard
Coach portés acrobatiques : HL Gasnier
Regard dramaturgique : Cécile Morelle
Regard extérieur : Idriss Roca
Prochaines dates
Du 27 au 30 novembre : Maisons pour Tous (Montpellier)
Du 7 au 9 janvier 2026 : Théâtre de la Coupe d’Or (Rochefort) en décentralisation
Du 17 au 21 février 2026 : tournée des médiathèques et bibliothèques de Vendée
3 et 4 avril 2026 : Festival Noob (Pont-Audemer)
Tous nos articles Cirque.