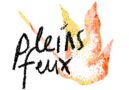Vu dans le cadre du Festival d’Avignon 2025, Par autan est l’ultime création de François Tanguy, disparu en 2022. Le titre évoque ce vent venu de la mer qui traverse les reliefs, et souffle ici sur un plateau saturé de bois, de toiles, de voix et de musiques : celles de Kleist, Tchekhov ou Walser, de Brahms, Sibelius ou Stockhausen. Le spectacle propose une expérience rare, où l’écoute précède le sens, et où l’image naît moins de ce qu’on voit que de ce qu’on perçoit. Plus qu’un récit à suivre, Par autan dessine un espace de résonance, dans lequel le théâtre se déploie comme un souffle partagé.
Par autan : Ce que le vent fait au théâtre
On ne sait pas très bien par quoi ça commence. Peut-être par un souffle. À l’avant-scène, de grands rideaux blancs, tendus comme des voiles. Derrière, un enchevêtrement de bois, de toiles, de structures mobiles. Cela évoque un entrepôt, un théâtre démonté, ou le décor d’un rêve en cours d’effacement.

Puis le vent arrive. Un vent réel. Il traverse le plateau, fait frémir les tissus, accompagne les voix. Rien ne commence vraiment. Rien ne s’installe. Ce n’est pas qu’il ne se passe rien. C’est plutôt que le théâtre, ici, prend son temps pour apparaître autrement. Non comme un dispositif d’explication, mais comme une zone de résonance, un espace où l’attention doit d’abord se poser avant de s’orienter.
La voix ne dit pas tout, et c’est tant mieux !
C’est précisément dans cet écart, entre reconnaissance et doute, qu’une pensée en germination se met à travailler.
On entend des voix. Elles apparaissent, repartent, parfois suspendues, parfois reprises. On reconnaît (ou croit reconnaître) des bribes : Hamlet, Kafka, Kierkegaard, Walser… Mais rien n’est souligné. Pas de clin d’œil au spectateur érudit, pas de mise en valeur. Les textes sont là, mais comme en filigrane, portés par la voix plus que par leur contenu. C’est peut-être une des premières surprises : ici, la parole ne sert pas à expliquer. Elle agit autrement, par tension, par vibration. Elle se tient au bord du sens. Le spectateur n’a plus à « suivre », mais à écouter sans savoir. Et c’est précisément dans cet écart, entre reconnaissance et doute, qu’une pensée en germination se met à travailler.
Des corps qui traversent, plutôt qu’ils ne jouent
À mesure que la parole circule, les figures apparaissent. Des comédiennes et comédiens passent, reviennent, se transforment. Une posture évoque un chevalier, une robe, une mariée, un regard, une grande bourgeoise. Mais tout cela glisse. Personne n’incarne vraiment. On ne nous demande pas de « croire » au rôle, simplement d’être attentifs à ce qui passe dans le geste, le costume, la voix. Il ne s’agit pas de représenter, mais de faire advenir une figure transitoire, un fantôme, par la traversée. Car chaque figure est à la fois là et déjà ailleurs. Le plateau devient une sorte de seuil, où rien ne se fixe mais où tout est chargé.

Et si les images naissaient d’ailleurs ?
L’oreille prend le relais. Et l’image, désormais, vient de l’écoute.
À ce stade, on pourrait chercher un lieu. Un décor. Une situation. Mais rien de cela n’est donné frontalement. Et pourtant, des images surgissent.Un rivage. Une ville. Un intérieur silencieux. On ne sait pas bien pourquoi-mais elles arrivent. C’est ici que le spectacle opère son tour de force : il décale le centre de gravité du regard. Ce qu’on voit ne vient plus de ce qui est montré. Cela vient de ce qu’on entend. D’un froissement de rideau, d’une phrase à demi-dit, d’un mot suspendu. L’oreille prend le relais. Et l’image, désormais, vient de l’écoute.
La musique, comme une oreille supplémentaire
Elle est partout, mais sans jamais s’imposer. Beethoven, Brahms, Mahler, Rachmaninoff, Scarlatti… Quelques phrases musicales surgissent, se retirent. Elles n’illustrent rien. Elles étendent l’espace. Elles accompagnent le déplacement. La musique, ici, ne sert pas de soutien émotionnel mais agit plutôt comme un fil souterrain, une manière de relancer l’écoute, de rappeler que le temps est aussi une matière. Elle participe au souffle général du spectacle, sans jamais chercher à prendre le devant.
Et après, qu’est-ce qu’il en reste ?

On ne sait pas vraiment ce qu’on a vu ! Et pourtant, il en reste une trace. Une tension, une respiration, une image qui s’est formée sans qu’on sache comment. Une voix qui a frôlé un point sensible, un souvenir latent et qui continue à résonner. Ce que Par autan propose, ce n’est pas une leçon, ni une fable, ni un dispositif conceptuel. C’est un paysage d’écoute, une manière de laisser le théâtre passer par les marges, par l’invisible, par l’infime.Il ne faut pas chercher à le saisir. Mais si l’on accepte de s’y perdre un peu, une empreinte se dépose, doucement, presque à notre insu. Et c’est là, peut-être, que cette esthétique agit le plus fortement : dans ce décalage discret qui nous rééduque sans discours.
Par Autan
Mise en scène, scénographie – François Tanguy
Avec – Frode Bjørnstad, Samuel Boré, Laurence Chable, Martine Dupé, Erik Gerken, Vincent Joly, Anaïs Muller
Son – Éric Goudard, François Tanguy
Lumière – François Fauvel, Typhaine Steiner, François Tanguy
Couture – Odile Crétault
Construction – François Fauvel, Erik Gerken, Jean Guillet, Jimmy Péchard, Paul-Emile Perreau
Régie générale – François Fauvel
Régie lumière – François Fauvel, Typhaine Steiner
Régie son – Éric Goudard, Emmanuel Six
Production / Diffusion – Geneviève de Vroeg-Bussière
Diffusion internationale – Arafat Sadallah
Comptabilité - Agnès Bedet
Communication - Martine Minette
Secrétariat – Marine Evrard
Vu au Festival d’Avignon le 13 juillet 2025.
Tous nos articles sur le Festival d’Avignon.