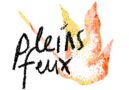Au Théâtre 13, Anthony Martine présente son seul en scène Quand on dort on n’a pas faim, un récit de vie sous forme de conte moderne entre les vieilles pierres du lycée Henri IV, le tourbillon de Grindr et les rêves d’un jeune homme.
C’est difficile d’écrire sur le spectacle d’Anthony Martine. C’est la première pensée qui m’a traversée en sortant de la salle du Théâtre 13, après une première joyeuse et une standing ovation méritée par un public acquis à la cause, majoritairement jeune, queer et/ou racisé. C’est difficile d’appliquer à un spectacle aussi radicalement personnel les catégories habituelles de l’analyse critique ; et pourtant, pourquoi hésiter sur ce seuil, si ce n’est par une mauvaise conscience de ne pas forcément être la bonne personne pour écrire sur ce travail. Et en même temps, Anthony Martine nous le dit bien pendant le spectacle, en citant Douce Dibondo : « On n’en a rien à faire de votre culpabilité ». Vous, ce sont les Blancs. En tant que femme blanche, je me sens parfois plus proche de certaines discriminations relatées par la communauté queer, parce qu’elles ont trait au genre, et que sur certains aspects elles se rejoignent. Mais les discriminations raciales me sont étrangères. J’écris avec mes angles morts.
A l’ombre du château

Anthony Martine raconte son histoire comme un conte, un conte à l’esthétique kitsch et volontairement de bric et de broc – du carton pâte, des faux flambeaux en marbre comme dans la Belle et la Bête de Cocteau, des rideaux à franges en papier crépon, une épée d’Excalibur en toc. Lui, par contre, est magnifique : une créature à la démarche de reine du drame sur ses bottes à talons, corset, faux ongles de sorcière en griffes de cauchemar et le plus frappant, une blackface totale avec lèvres rouges, le vrai visage des paquets de Banania. L’image est complète, et raconte déjà beaucoup des différents masques qui luttent à l’intérieur de notre héros-héroïne. C’est cette bataille d’identités qu’interroge le performeur dans ce spectacle hybride : comment se construire quand on est un jeune homme noir queer qui se nourrit de modèles blancs féminins du cinéma (Fanny Ardant, Catherine Deneuve…) ? Comment s’intégrer dans le « château » (ici, le lycée Henri IV sur la montagne Sainte-Geneviève) lorsque les « princes », auprès desquels on pensait avoir fait illusion, vous envoient des images de singes par texto ? Comment garder le cap lorsqu’on mélange la pression de la prépa et du masque social du « meilleur ami sympa » (ou du bouffon…) pour une bande de bourgeois inconscients, avec le rôle de jeune gay noir fétichisé sur Grindr ?
J’ai eu l’impression d’assister à un réglage de comptes qui prendrait la forme d’un rituel : c’est qu’il y a beaucoup à exorciser.
Anthony Martine utilise les codes de l’esthétique drag où tout est grandi, exagéré, en passant du faux ton de conteur pour enfants au mauvais ange gardien de « Paris Ardant » qui accompagne ses soirées folles. Tout est « trop », pour en montrer les contours et pointer le cœur politique des questions soulevées. C’est qu’il y a beaucoup à exorciser. J’ai eu l’impression d’assister à un réglage de comptes qui prendrait la forme d’un rituel, avec une panoplie d’outils à sa disposition : situations théâtrales, récit, archives personnelles, moment lypsinc (incroyable), numéro de drag. Il faut souligner la souplesse du performeur qui passe du ton kitsch et surjoué du conteur à une émotion brutale qui apparaît d’un coup. Dans cette bataille de masques, on aurait envie de gratter le maquillage pour voir le visage en-dessous, mais c’est sans doute trop tôt. En contrepoint, on sent la présence quasi mystique de Mérèndys Martine, la sœur du performeur, assise dans un coin de ce petit théâtre de conte, à tresser des tissus – comme la princesse dans la tour tresse ses cheveux, ou des draps pour s’en faire une corde et enfin, s’échapper.
Au bout du conte
Et pourtant, il y a quand même un peu de commun entre le performeur et moi : si je ne connaîtrai jamais l’addiction à Grindr ou ne comprendrai ce que c’est d’évoluer dans une société encore fondamentalement raciste, moi aussi j’ai connu Henri IV et l’escalier des Prophètes, en étant une petite banlieusarde modeste qui n’avait rien à faire là, et à qui on le faisait bien sentir. La violence symbolique opère à tous les niveaux. C’est une histoire de reconquête d’identité qui résonne avec d’autres récits de transfuges de classe ou de migrants : ne te mélange pas avec les tiens, fais semblant, apprends, fonds-toi, imite, disparais. Avec la forme du conte, Anthony Martine relie les fils de plusieurs histoires où quelque chose résonne un peu pour tous·tes.
A un moment, le conte se dissout. Mais peut-être que de cette forme-là aussi, trop blanche, il fallait se défaire…
Par contre, Anthony Martine choisit – et ça m’a un peu manqué dans l’écriture – de ne pas raconter son arrivée au théâtre, à cette forme-là qui danse et bouge et bouffe le plateau ce soir, cette créature de paillettes qui semble avoir laissé loin derrière elle le petit jeune homme à lunettes qui voulait tant s’intégrer. On sent que cet espace est son lieu de liberté où il instaure ses propres règles, et où il a trouvé un langage propre, mais la transition demeure un mystère. A un moment, le conte se dissout. Mais peut-être que de cette forme-là aussi, trop blanche, il fallait se défaire… Et le récit d’initiation prend fin, le « à nous deux Paris » se transforme en autre chose, de plus intime et de plus simple aussi.

D’ailleurs c’est sans doute cette dernière partie qui m’a plus touchée, probablement parce qu’elle abandonne pas mal d’oripeaux et qu’elle laisse la place à un dialogue doux. On entend enfin la voix de Mérèndys Martine, l’accompagnatrice discrète, l’alliée de l’ombre qui attendait l’heure de la révélation à soi : « mais tu étais où pendant tout ce temps ? » demande le performeur. « J’étais juste là », répond-elle en souriant. J’ai envie de laisser aux spectateur·ices la douceur de découvrir cette dernière partie, qui est comme une sorte d’observatoire de toute cette proposition théâtrale sous l’angle d’une petite ironie, de beaucoup de tendresse, et d’une certaine intransigeance aussi sur les mécanismes à l’œuvre. Oui, le racisme est toujours parmi nous, n’en déplaise à notre assemblée de gauchos. Et dans le conte, Anthony choisit de ne plus être ni la princesse, ni le monstre, ni le bouffon – peut-être plutôt la sorcière ou le phénix, qui peut se transformer sans cesse pour ne pas être figé dans un rôle. « Invente ta propre histoire ». Avec ce spectacle-performance si personnel, Anthony Martine tue ses démons avec panache.
Quand on dort on n’a pas faim
Écriture et mise en scène – Anthony Martine
Avec – Anthony Martine et Mérèndys Martine
Assistant à la mise en scène – Fabien Chapeira
Dramaturgie – Léo Brandon Barret
Création musicale et musique live – Louise Bsx
Création vidéo – Maël Kadjan
Création lumière – Jérome Baudoin
Scénographie et accessoires – Shehrazad Dermé
Assistanat scénographie – Maya Ali
Chargé de production et de diffusion – Sergio Chianca
Production – Festival Jerk Off
Coproduction – Théâtre 13
Compagnie Le Cri
À voir au Théâtre 13/Glacière (Paris), du 1er au 11 octobre 2025.
Prochaines dates
15 et 16 octobre – TU Nantes, dans le cadre du festival Fauves
7 au 11 avril – CCNRB, dans le cadre du Festival Mythos, Rennes
Lire notre entretien avec Anthony Martine.
Tous nos articles Performance et Théâtre.