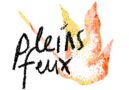Au Théâtre de la Tempête, le dramaturge François Hien met en scène dans La Peur la confrontation entre un curé tiraillé et un jeune homme victime d’un prêtre pédocriminel. Remarquable de clarté et d’intelligence, ce spectacle articule les questions de la dissimulation des violences sexuelles, de la responsabilité morale personnelle et collective, et de l’homosexualité dans l’Église, avec une écriture incisive et une structure dialectique féroce.
Comment une institution, pourtant animée par « l’amour du prochain » parvient-elle à cacher pendant des années des faits de violence ? Comment un homme a priori bon et intègre peut-il lui aussi en venir à participer à un système d’omerta ? Quelles sont les racines profondes d’un tel système d’emprise collective ? Ce sont ces questions que prend à bras le corps François Hien dans sa dernière pièce, La Peur, présentée au Théâtre de la Tempête, et dont il signe aussi la mise en scène avec Arthur Fourcade. Fidèle à lui-même, l’auteur de La Honte se saisit à nouveau d’un sujet de société aux ramifications complexes et aux enjeux moraux et politiques emmêlés, et en extrait une fiction diablement efficace qui en éclaircit les positions sans jamais les simplifier.
Conscience morale et responsabilité collective
La Peur dépasse sa prémisse, celle d’une pièce sur les mécanismes d’invisibilisation des violences sexuelles au sein de l’Église, et devient une œuvre sur le cheminement moral d’un homme.
La Peur est ainsi l’histoire du Père Eric Guérin (Arthur Fourcade), curé sans paroisse qui, après avoir dénoncé les actes pédocriminels d’un autre prêtre qui s’était confessé à lui, se rétracte sous la pression de sa hiérarchie (l’évèque Monseigneur Milliot (Marc Jeancourt)) et la promesse d’une nouvelle paroisse, et que vient alors confronter tous les dimanche après la messe le jeune Morgan (Pascal Cesari, en alternance avec Mikaël Tréguer), une des victimes du pédophile. Colonne vertébrale de la pièce, leurs déjeuners dominicaux deviennent l’arène où s’affrontent par la parole les visions des deux hommes. Morgan porte sa haine comme un bouclier, et exprime sa colère, son dégoût et son incompréhension face aux mécanismes de pouvoir et de corruption dont lui semblent témoigner l’Église et la lâcheté du Père Guérin. Celui-ci oppose quant à lui au jeune homme un récit de soi autant qu’une posture théologique qui tente souvent maladroitement, sinon d’excuser, au moins d’expliquer sa position.
Dépassant le conflit, le récit de Guérin remonte dans son passé. Il convoque des souvenirs intimes, qui font apparaître la raison de sa mise au placard de l’Église une quinzaine d’années auparavant : une liaison homosexuelle assumée avec un jeune homme marocain, Tawfik, rencontré lors de son ermitage au Maroc, et qu’il a aidé à s’installer en France. La Peur dépasse alors sa prémisse, celle d’une pièce sur les mécanismes d’invisibilisation des violences sexuelles au sein de l’Église, et devient une œuvre sur le cheminement moral d’un homme, qui essaie de faire sens de son existence alors qu’elle est ébranlée par les positions antagonistes des personnes autour de lui : Morgan, la victime qui demande justice, Tawfik, l’ancien amant, et sa sœur Mathilde, seul personnage féminin de la pièce (Estelle Clément-Bealem, en alternance avec Laure Giappiconi). Le Père Guérin se présente ainsi comme un personnage ambigu, dont les débats internes sur l’acceptation de soi, l’amour et le pêché, sont dénoncés par Morgan comme des « petites tractations morales » insignifiantes au regard de la responsabilité sociale de ses actes.

Une pièce dialectique
Les dialogues agissent comme des débats d’arguments qui, loin de vulgariser ou de polariser les positions, s’attachent à en éclairer les zones d’ombre, à en dessiner les contours, à en sculpter minutieusement les tenants et les aboutissants.
L’écriture de François Hien est remarquable de clarté et de précision. En embrassant la conflictualité inhérente à ces questions brûlantes, l’auteur illumine la complexité des postures : les dialogues agissent comme des débats d’arguments qui, loin de vulgariser ou de polariser les positions, s’attachent à en éclairer les zones d’ombre, à en dessiner les contours, bref, à en sculpter minutieusement les tenants et les aboutissants. Elle articule autour de grandes oppositions les enjeux structurants de la pièce : le pardon contre la vindicte, le secret contre la publicisation, l’individu contre l’institution et contre la société, l’humilité contre l’orgueil, l’Éternité contre les souffrances mondaines, la conscience contre la vie réelle, le bonheur et la vérité contre la peur et le mensonge. Avec La Peur, comme ses précédentes œuvres, François Hien continue de porter brillamment la conception proprement dialectique du théâtre, celle dans laquelle c’est par la confrontation des mots et des idées que l’esprit et la société progressent.
Dans cette optique, la scénographie simple conçue par Anabel Strehaiano fait du plateau un échiquier – le damier noir et blanc au sol symbolise à la perfection la dimension agonistique de la pièce. Le Père Guérin y apparaît comme un roi mis en échec par l’action conjointe d’un fou (Morgan), d’un cavalier (Tawfik) et d’une tour (Mathilde). Dans ce jeu géométrique des positions respectives, les lignes de tension claires permettent un réagencement progressif – c’est par la discussion, l’échange, avec ce qu’il peut avoir de frontal et heurtant, que le Père Guérin va modifier sa position. La pièce reproduit ainsi dans sa forme ce qu’elle affirme dans le fond : qu’une institution aussi rigide que l’Église ne pourra pas être amendée de l’intérieur, trop ancrée dans ses logiques solidifiées, mais par la confrontation avec des perspectives marginales et extérieures. « Vous savez quel est votre problème, à vous les curés ? Vous n’êtes qu’entre hommes » s’exprime par exemple Mathilde. Et de démontrer que la force de la foi, laissée à elle-même, provoque plus qu’elle ne repousse le pêché. Son personnage est le pendant clairvoyant du père Guérin, et ses réflexions sur les défauts structurels et moraux de l’institution, conjugués à la prise de conscience de Morgan sur la place de l’homosexualité dans celle-ci, marquent par leur pertinence à l’échelle de la fiction comme du réel. Elles permettent à la pièce de s’acheminer vers un final particulièrement théâtral où la logique de l’Église est retournée contre elle.

Contingences scéniques et transcendance théologique
Néanmoins, La Peur ne se repose pas uniquement sur son efficacité dramaturgique et dialectique. Au cœur de ces échanges, elle insère de véritables moments d’intimité et d’intériorité qui nourrissent d’images et de sensations l’évolution du père Guérin. Ainsi de l’histoire d’amour avec Tawfik, qui, le soir du mercredi 29 janvier où nous avons vu la pièce, était interprété par Imane Doughoui, une jeune étudiante comédienne remplaçant au pied levé, et texte en main, l’interprète initialement prévu devenu indisponible. Loin de créer une distance, cet intérim accidentel non seulement prouve la qualité de l’écriture de François Hien dont l’efficacité et la clarté demeurent malgré les contingences, mais il ajoute une dimension supplémentaire à la relation d’Eric et de Tawfik. En effet cette relation, qui dans son déploiement narratif interroge les biais inhérents à la différence d’âge et de classe sociale, et au contexte post-colonial, était ce soir-là subtilement surlignée du déséquilibre même qui existe entre l’acteur professionnel et l’actrice débutante, celui qui maîtrise le texte (comme le curé maitrise la langue française) et celle qui doit le tenir en main et s’y référer (comme Tawfik est encore en phase d’apprentissage des subtilités du français).

Autre moment de grâce, le « monologue théologique » du Père Guérin, qui, s’il semble n’être au départ qu’une étrange parenthèse dans une pièce aux enjeux très concrets et politiques, donne corps aux motivations profondes du personnages. En cherchant à concilier plusieurs dogmes contradictoires sur la question du salut et du moyen par lequel le Christ se manifeste aux hommes, le Père Guérin dessine une théorie qui met au centre l’humilité – une humilité qui, poussé à l’extrême, nourrit en fait ses renoncements et ses refoulements. Investi avec un engagement à la fois doux et total par Arthur Fourcade, ce monologue est le véritable cœur du texte, et offre au personnage et à la pièce un caractère philosophique qui en complémente et renforce les dimensions politiques.
Documentée avec sérieux à partir d’enquêtes sociologiques (Des soutanes et des hommes, Josselin Tricou) et d’essais de théologie militante (La Foi au-delà du ressentiment – Fragment catholiques et gays de James Allison), La Peur articule avec brio ses sujets complexes et ses personnages dans une fiction d’une grande force dialectique et d’une subtilité thématique indéniable. Elle témoigne une nouvelle fois du remarquable talent de François Hien à se saisir des nœuds sociétaux et moraux, pour les démêler avec une écriture incisive et exigeante.
La Peur
Texte – François Hien
Mise en scène – Arthur Fourcade, François Hien
Avec – Estelle Clément-Bealem en alternance avec Laure Giappiconi (8, 9 et 11 février), Ryan Larras (8 au 16 février) en alternance avec Kadiatou Camara et Imane Doughoui (29 et 30 janvier), Pascal Cesari (24 au 29 janvier) en alternance avec Mikaël Treguer (30 janvier au 16 février), Arthur Fourcade, Marc Jeancourt
Régie générale et lumières – Nolwenn Delcamp-Risse
Scénographie – Anabel Strehaiano
Costumes – Sigolène Petey
du 24 janvier au 16 février au Théâtre de la Tempête
Rencontres autour du spectacle :
– le jeudi 6 février(avant la représentation, à 19h) : avec Lucy Sharkey Aouad, autrice d’Oh My Goddess!
– le mercredi 12 février (avant la représentation, à 19h) : avec James Alison, prêtre et théologien, auteur de La Foi au-delà du ressentiment
– le jeudi 13 février (avant la représentation, à 19h) : avec sœur Véronique Margron, présidente de la CORREF
Tous nos articles Théâtre.