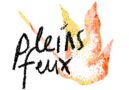Comme chaque année durant le Festival d’Avignon, la Sélection Suisse en Avignon, programmation parallèle qui accompagne des productions issues de Suisse francophone, affirme la vitalité et l’inventivité des scènes helvétiques contemporaines. Présentant six projets variés, du jeune public à la danse contemporaine, en passant par le théâtre et la performance, elle offre un panorama toujours captivant et des expériences souvent singulières. Pleins Feux se penche aujourd’hui sur deux de ces propositions – Les Impromptus, de Cindy van Acker à la Collection Lambert, et L’événement de Joëlle Fontannaz à la Manufacture – qui, en déplaçant notre perception, invitent à renouveler notre sensibilité.
Y a-t-il une manière spécifiquement helvétique de faire du théâtre, ou de la danse ? Difficile de donner une réponse à cette question tant la création contemporaine, en France comme en Suisse ou ailleurs, est diversifiée. Néanmoins, chaque année au festival d’Avignon, je garde un œil très attentif sur une programmation devenue au fil des ans incontournable, celle de la Sélection Suisse. Pilotée par Esther Welger-Barbosa, ce dispositif accompagne en Avignon des créations suisses romandes, en partenariat avec des lieux identifiés du festival tels que La Manufacture, la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, la Collection Lambert, ou encore Les Hivernales CDCN.
Aller à un spectacle de la Sélection Suisse, c’est l’assurance d’assister à un objet théâtral ou chorégraphique unique, décalé, troublant, voire radical. C’est tomber sur des pépites ovniesques à la singularité rarement égalée. Les années précédentes, j’y avais ainsi découvert l’inénarrable Cécile de Marion Duval, le bouleversant Ouverture de Géraldine Chollet, et le flamboyant Niagara 3000 de Pamina de Coulon. Autant de coups de cœur qui ont durablement marqué mon expérience de spectateur.
Je reviens aujourd’hui sur deux propositions sur six de la cuvée 2025 de la Sélection Suisse, entièrement féminine : Les Impromptus de Cindy Van Acker, présentés dans les salles de la Collection Lambert, et L’événement de Joëlle Fontannaz, présenté à La Manufacture. Deux propositions uniques chacune à leur manière, qui interrogent les modalités d’être de l’œuvre d’art vivant, et la façon dont sa forme est fondamentalement vectrice du sens. En déplaçant notre regard et notre écoute dans des territoires inhabituels de la perception, elles demandent une exigence d’attention toute particulière et invitent à une sensibilité renouvelée au temps et à autrui.
Les Impromptus : temps et matière

Une danseuse se tient debout, immobile dans la cage d’escalier en spirale de la Collection Lambert, yeux clos. Le soleil qui entre par la verrière du toit traverse la pièce et dessine un unique rayon sur son visage serein. Petit à petit la ligne qui départage l’ombre et la lumière semble se déplacer, et le soleil s’étendre sur sa peau… Est-ce l’insensible effet de la rotation de la Terre, rendu ici visible, qui fait bouger cette lumière, sur ce cadran humain ? Ou plutôt, ce que nous prenions pour de l’immobilité n’en est pas tout fait, car un très léger mouvement de balancier, quasi-imperceptible, anime ce corps dressé. La durée s’étire, et nous force à être attentif à ce qui aurait d’ordinaire échappé à notre perception. Sur le mur s’affiche une phrase d’Albert Camus, extraite de La postérité du soleil : « Même les soleils sont ivres. », titre de l’exposition en cours. Dans cet espace blanc de musée, la danseuse semble avoir acquis une autre qualité – elle est une œuvre plastique à part entière, dont la force de présence découle de son placement, de son éclairage, de sa matière. Mais dans cette exposition consacrée au vent et aux expériences sensorielles du territoire provençal, elle est également élément, végétal et minéral – son mouvement évoque celui du tournesol qui cherche la lumière ou celui, d’une lenteur plus ancrée encore, de la pierre qui voit défiler les jours. La contemplation, la sensibilité qu’elle convoque nous extraient de la temporalité quotidienne, inventent une perception intérieure où se propagent de lignes de fuite, des perspectives insoupçonnées.
Les danseur·euses de Cindy van Acker se mêlent sans heurts à l’œuvre, s’incorporent à l’espace comme s’il avait toujours été pensé pour accueillir ces présences.
La lenteur est un des fils directeurs du travail de Cindy Van Acker, chorégraphe belge basée à Genève avec sa compagnie Greffe depuis une vingtaine d’années, et qu’on connaît également comme collaboratrice de Romeo Castellucci, des spectacles duquel elle signe une partie des chorégraphies. Cette temporalité lente du mouvement, de la présence, qui redéfinit un autre rapport à l’espace et à l’attention, s’inscrit dans le caractère éphémère du projet des Impromptus : chaque jour, une œuvre ou une salle différente du musée est choisie, et une performance spécifique y est créée et performée dans l’après-midi. Ainsi, chaque itération des Impromptus est totalement unique, et entre en dialogue avec une ou plusieurs œuvres exposées. En ce premier jour, la solitaire danseuse ensoleillée laisse place, dans une seconde salle, à une performance à plusieurs. On y voit deux corps dos-à-dos former un étrange crabe, comme tout droit sorti de la vidéo de Joan Jonas, Wind, puis se fondre au sol avec l’arrivée d’une troisième danseuse, dans une forme de magma humain, tandis qu’un ballon atmosphérique – l’installation Air de l’artiste Martin Creed – se déplace au gré d’un ventilateur, tel un danseur non-humain. Les danseur·euses de Cindy Van Acker se mêlent sans heurts à l’œuvre, s’incorporent à l’espace comme s’il avait toujours été pensé pour accueillir ces présences. Leur dialogue dans ce premier impromptu raconte quelque chose la nature élémentaire des êtres, de la trame profonde et sensible du monde : les mouvements invisibles de l’air rendus visibles par le ballon, et les corps devenus magmas, répondant au mouvement minéral-végétal de la première danseuse. Dans cette approche chaque jour renouvelée, c’est ainsi toute une expérience nouvelle du temps, de l’espace et du sensible que Cindy Van Acker invite à vivre.

L’événement : heurs et malheurs de la communauté par la parole
Cette superposition des voix engendre une tension élastique entre fusion et individuation, au gré des échos, répétitions, dissonances et harmonies qui structurent la narration.
Un homme et deux femmes, debout sur un rocher, énoncent une série de commandements : « On doit faire avec ce qui est. », « On doit oser, pas nier la fragilité. », « Raconter l’histoire ensemble. », « Savoir pourquoi on dit ce qu’on dit »… Mais également une liste de possibles : « on peut se toucher, se parler. » Qui sont-ils ? Trois membres d’une communauté de méditation auto-gérée sur une île de la Méditerranée, qui nous racontent le fameux événement : l’incendie d’un four à pizza. Celui-ci importe peu dans sa signification directe, c’est le récit en lui-même qui est au centre du spectacle, et surtout la parole dans sa matérialité, sa consistance, sa force performative. En effet, les trois interprètes forment un chœur polyphonique, racontent la même réalité à trois voix qui se superposent, tantôt s’éloignant en variations distinctes, tantôt se rejoignant sur une même phrase. Imaginez trois personnes qui vous racontent la même histoire, en même temps, avec chacun·e ses mots et ses tournures de phrase et vous aurez une idée d’à quoi ressemble L’événement. En grande partie improvisée sur un canevas quant à lui précis, cette superposition des voix engendre une tension élastique entre fusion et individuation, au gré des échos, répétitions, dissonances et harmonies qui structurent la narration. L’ensemble provoque une sensation de désorientation doublée d’une vision étrange d’un collectif – un collectif en constante lutte avec lui-même pour rester soudé sans s’uniformiser, et inversement se singulariser sans se décomposer.

La brillance de la pièce de Joëlle Fontannaz, malgré son apparence conceptuelle, est qu’elle raconte précisément la difficulté de la vie en groupe, de la persistance du faire-communauté dans les circonstances de l’accident, en la transposant dans une matière par essence théâtrale, celle de la parole comme flux structurant de l’œuvre. S’il est « cool de vivre ensemble dans la paix » et de construire un four à pizza pour faire des soirées au clair de lune, l’utopie communautaire se heurte aux obstacles de la cohabitation, de la question du leadership, de la désolidarisation – à la difficulté de faire corps dans un même espace. Une condition représentée au plateau sur un plan symbolique par ce petit rocher accidenté sur lequel les trois comédien·nes doivent coexister, arrangeant sans cesse leurs placements respectifs pour trouver la meilleure organisation spatiale possible pour leurs trois corps. Mais L’événement n’est jamais pessimiste pour autant, car il émerge de cette interaction inconfortable le désir et la nécessité de travailler sans cesse à la rendre possible. D’où la formulation et la reformulation régulières de ce qu’on peut et de ce qu’on doit – un accueil de la parole d’autrui, une attention à sa sensibilité, une conscience des perspectives individuelles, un soin les uns des autres. L’harmonie se construira à ce prix.
Les Impromptus
Conception et chorégraphie – Cindy van Acker
Performeur·ses – Matthieu Chayrigues, Tilouna Morel, Daniela Zaghini, rejoints les 15 et 16 par Stéphanie Bayle
Conception sonore – Denis Rollet
Du 11 au 16 juillet à 17h à la Collection Lambert
L’événement
Conception et mise en scène – Joëlle Fontannaz
Écriture et jeu – Joëlle Fontannaz, Mathias Glayre, Nina Langensand Collaboration à l’écriture Adina Secretan
Dramaturgie – Sébastien Grosset, Adina Secretan
Création lumière – Vicky Althaus
Costumes et maquillages – Vincent Deblue
Scénographie – Sarah André et Vincent Deblue
Aide costume – Baptiste Sorin
Aide construction décor – Florian Gibat
Création son – Marcin de Morsier
Régies – Redwan Reys
Du 7 au 20 juillet à 18h15 à La Manufacture
Découvrez toute la programmation de la Sélection Suisse en Avignon.
Tous nos articles sur le Festival d’Avignon.