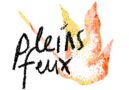Au Théâtre de la Manufacture – CDN de Nancy, la compagnie Lucie Warrant présente le troisième volet de sa quadrilogie de la métamorphose, adapté de l’œuvre de Nastassja Martin Croire aux fauves. À la mise en scène et au jeu, Laure Werckmann s’empare du récit de la rencontre de l’anthropologue avec un ours, et de ses notions centrales de porosité, de rêve et d’hybridité, pour proposer un spectacle fidèle, sensible et ingénieux, bien qu’un peu timide dans son adaptation.
Dans la lueur rouge d’un vestibule, à moins que ce ne soit une loge, une femme debout s’habille et se regarde longuement dans le miroir. Qu’y a-t-il sur son visage, ou sous celui-ci ? La femme arrive, pose son sac à dos, s’installe sur une chaise, le dos vouté, garde son foulard et son blouson en jean. Et puis, c’est une chargée de relations public du théâtre qui prend la parole au micro, en avant-scène. Et par un retournement étrange, on se croirait déjà au moment bord plateau, alors même que le spectacle n’a pas encore vraiment commencé ! Son invitée n’est autre que Nastassja Martin, anthropologue, disciple de Philippe Descola, et autrice d’enquêtes ethnographiques auprès de peuples animistes du grand nord, les Gwi’chin en Alaska et les Even au Kamchatka. C’est lors de ce dernier terrain, en extrême-orient russe, qu’elle a fait la rencontre qui a bouleversé sa vie : en haut des montagnes, un ours, qui lui saute au cou et lui arrache la moitié du visage, mais la laisse vivante. L’anthropologue en fait le récit dans Croire aux fauves, qu’adapte aujourd’hui pour la scène la compagnie Lucie Warrant, implantée en région Grand Est. Un texte vertigineux qui entrelace le récit de sa reconstruction physique et mentale à des considérations anthropologiques sur la nature de notre relation au monde vivant, par le prisme de la pensée animiste.
La porosité et le rêve
L’animisme est précisément le sujet des premières questions de ce faux bord-plateau, conférence reconstituée en guise d’introduction à l’histoire de Nastassja. En prenant le temps de nous faire entendre son discours, Laure Werckmann – qui à la fois adapte, met en scène et interprète quasi-seule en scène l’anthropologue – montre qu’elle n’a pas peur de la pensée. Elle n’édulcore pas le contenu proprement anthropologique et philosophique du récit de Nastassja Martin, qui donne le contexte de son expérience, et qu’on retrouve dans son ouvrage À l’Est des rêves. Sur la démarche anthropologique, Nastassja nous prévient : il s’agit avant tout de « donner du temps au silence », « d’avoir un regard d’enfant » (lesquels entretiennent d’ailleurs souvent une disposition naturelle à l’animisme, parlant aux non-humains avec facilité), de se départir de nos a priori et d’avoir une disposition du corps « poreuse ». La porosité, c’est le concept central du spectacle, le fil rouge d’une mise en scène qui cherche à en décliner les potentialités au plateau. À commencer bien sûr par cette longue introduction entre fiction et réel, entre scène et salle, poreuse d’une manière que le théâtre sait si bien faire.
Le sujet de Croire aux fauves, c’est jusqu’où on va dans cette porosité et comment on en revient, surtout lorsque cette porosité s’insinue jusque dans votre manière de rêver
Nastassja Martin
Croire aux fauves brille régulièrement par ses intuitions scéniques, qui traduisent avec intelligence et simplicité dans la scénographie les concepts mobilisés par l’anthropologue dans son récit.
Le rêve est un autre fil rouge – rouge comme le néon Dream branché au dessus du rideau de velours dans le petit vestibule, image lynchéenne teintée d’ironie. Car le rêve dont parle Nastassja Martin n’est pas le rêve occidental, projectif et centré sur l’expérience du soi, mais un autre rêve, animiste, qui cherche à sortir de son corps pour aller à la rencontre de l’altérité. Le petit vestibule se transforme en cabine d’écoute où les songes de l’anthropologue viennent scander les parties du spectacle. Nastassja rêve d’ours et de saumon, rêve qu’elle est le saumon qui remonte la rivière, attrapée par l’ours, rêve qu’elle est l’ours qui chope le saumon… Les rêves, racontés par cette voix d’outre-conscience, sont le terrain de l’hybridité absolue, du retour à un « temps du mythe ». Et pour en finir avec le rêve projectif, elle déchire d’un coup de piolet – comme celui qu’elle a asséné à l’ours dans leur empoignade – le grand écran de papier, créant une ouverture béante qui fait écho à la déchirure de son visage. On retrouve là la porosité, très matériellement. Le grand écran finira par tomber au sol, comme la frontière abolie entre les règnes humain et animal, reprenant les mots de Martin : « L’événement est : un ours et une femme se rencontrent, et les frontière entre les mondes implosent. » Croire aux fauves brille régulièrement par ses intuitions scéniques, qui traduisent avec intelligence et simplicité dans la scénographie les concepts mobilisés par l’anthropologue dans son récit.

Une adaptation timide
Pour le reste, l’adaptation de Laure Werckmann reste fidèle à la structure du livre – découpé en quatre saisons. On y suit le parcours de guérison de Nastassja Martin, d’hôpitaux russes au retour à la maison, en passant par le service de chirurgie maxillaire de la Salpêtrière, où son visage devient le théâtre d’une étrange guerre froide médicale. Celui-ci est entrecoupé de ses souvenirs du Kamchatka et de l’événement, puis de son nouveau départ là-bas, auprès de son clan Even et de Daria, la mère de famille et amie, et les moments où l’on se raconte les rêves au coin du feu. Si cette trame est racontée fidèlement par Laure Werckmann, le spectacle pâtit néanmoins un peu d’une interprétation trop sage.
En comparaison avec la puissance poétique et philosophique de l’écriture de Nastassja Martin,, on a du mal à discerner dans cette figure de femme le chamboulement quasi-métaphysique qu’elle traverse.
En comparaison avec la puissance poétique et philosophique de l’écriture de Nastassja Martin, et malgré la pertinence des images scéniques, on a du mal à discerner dans cette figure de femme le chamboulement quasi-métaphysique, en tout cas à la fois corporel et mental, qu’elle traverse. En effet, en dépit du maquillage et des prothèses de tissu conçus par Cécile Kretschmar pour signifier la blessure et la cicatrice, la comédienne ne s’aventure que peu sur le terrain d’une véritable métamorphose au plateau. Or, celle-ci est pourtant le sujet de la quadrilogie de spectacles de la compagnie, dans laquelle s’inscrit Croire aux fauves, et qui met en avant des vies de femmes passées par une transformation, une métamorphose (les derniers volets sont ainsi consacrés à Marion Bartoli et Marceline Loridan-Ivens). Si, au demeurant, il est toujours fascinant d’entendre les phrases de Nastassja Martin et de faire ce trajet avec elle, il nous semble que la pièce ne se saisit pas assez des potentialités métamorphiques qu’ouvre le texte, sinon dans une séquence finale décalée et poétique.
Croire aux fauves reste un spectacle doté d’intuitions brillantes et d’une grande sensibilité, auquel il manque sans doute, au vu de son matériau d’origine, un soupçon d’hybridité et de porosité, pour nous emporter complètement au temps du mythe.
Croire aux fauves
D’après – Croire aux fauves de Nastassja Martin, éditions Gallimard 2019
Adaptation, mise en scène – Laure Werckmann
Avec – Laure Werckmann
et les régisseuses – Cyrille Siffer et Zélie Champeau
Masques et perruques – Cécile Kretschmar
Lumière – Philippe Berthomé
Scénographie – Angéline Croissant
Musique – Olivier Mellano
Costume – Pauline Kieffer
Collaboration à la mise en scène – Noémie Rosenblatt
Prochaines dates
14 et 15 octobre – Comédie de Colmar Centre Dramatique National Grand Est – Colmar (68)
27 janvier 2026 – Théâtre de la Madeleine – Troyes (10)
26 et 27 mars 2026 – Espace Bernard Marie Koltès – Metz (57)
21 mai – Festival Les éphémères – Le Diapason – Vendenheim (67)
Tous nos articles Théâtre.