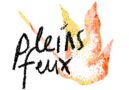En ouverture de saison du Théâtre 13, Quand on dort on n’a pas faim révèle le talent d’Anthony Martine en auteur, metteur en scène et acteur de sa propre histoire. Dans ce récit initiatique au décor de conte de fée, le comédien afro-caribéen queer pourfend le racisme et exorcise ses démons à grands coups de performance drag-médiévale (lire notre critique).
Dans cette conversation avec Pleins Feux, Anthony Martine revient sur son parcours de la prépa au théâtre et les sources de son spectacle, et raconte la construction progressive de son identité dans un monde dominé par les modèles de la culture blanche.
Yannaï Plettener : Dans ton spectacle Quand on dort on n’a pas faim, tu racontes ton arrivée à Paris à 17 ans, dans la prestigieuse prépa littéraire du lycée Henri IV. De là, comment es-tu arrivé au théâtre ?
Ce spectacle pour moi est bien plus qu’un spectacle, c’est une réunion, une célébration.
Anthony Martine : J’avais fait du théâtre en option au lycée. J’avais adoré cette expérience, mais je ne me voyais pas comme comédien, pour moi ce n’était pas un métier. J’ai donc arrêté et fait deux années de prépa au lycée Henri IV. Et à l’issue de ces deux années, je me suis demandé : qu’est-ce que je vais faire ? C’est ma prof de français d’alors qui m’avait dit : « Anthony, il faut que tu fasses du théâtre, c’est ça que tu dois faire ! » J’étais d’accord mais je ne savais pas comment. J’ai commencé en répétant dans son salon, et maintenant elle vient à toutes mes pièces : je ne peux pas vous dire toute la fierté que je ressens.
Ce qui m’arrive aujourd’hui, d’être comédien professionnel, et de faire ce spectacle, c’est fou, et à la fois ça me semble abstrait d’avoir fait autre chose que ça. Après la prépa, je suis entré directement au conservatoire municipal du XIIIe arrondissement. Ce qui est dingue, c’est que je joue maintenant au Théâtre 13, dans le XIIIe arrondissement : mon ancien professeur du conservatoire est venu voir la première du spectacle, et on m’a proposé d’intervenir dans sa classe, la classe où j’ai commencé ma formation de comédien. La boucle est bouclée. Et beaucoup de personnes viennent me voir, des anciens camarades de prépa, des professeurs… Ce spectacle pour moi est bien plus qu’un spectacle, c’est une réunion, une célébration.
YP : Dans ton parcours de comédien, tu as travaillé avec des artistes comme Rébecca Chaillon (dans Plutôt vomir que faillir) et le Munstrum Théâtre (dans Makbeth). Ce sont des théâtralités très différentes, mais très contemporaines. Qu’est-ce que ces expériences t’ont apporté ?
AM : Ça a vraiment changé ma vie. Quand j’ai auditionné pour le projet de Rébecca Chaillon, je suis allé voir Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute. C’était la première pièce d’elle que je voyais, et au bout des dix premières minutes, je détestais ! Mais à la fin, j’étais debout, en larmes. Comment était-ce possible de ressentir un si grand écart face à un même spectacle ? C’étaient des formes que je n’avais jamais vues. Elle joue beaucoup sur l’attirance et la répulsion.
Quand j’ai découvert Rébecca Chaillon, j’étais fou. Qui est cette femme ? Une metteuse en scène noire, queer, d’origine martiniquaise, qui adore les mangas… Tout comme moi ! J’y ai vu mon alter ego féminin. J’ai tout donné pour faire partie de son projet. Elle a quand même quelque chose d’historique : c’est la première femme noire à avoir mis en scène un spectacle à l’Odéon (Carte noire nommée désir). C’est incroyable.
Quand j’ai commencé ma formation en conservatoire, j’ai vu Quarante degrés sous zéro. Depuis, je rêvais de travailler avec le Munstrum. Mais c’était un rêve, je me disais que ça n’arriverait jamais. Jusqu’à ce que Louis Arene me propose de jouer dans Makbeth. Il y a des fées qui veillent sur moi…
Qu’il s’agisse de Rébecca ou du Munstrum, je trouve que leurs formes sont vraiment nouvelles. Elles sont différentes, oui, mais ont aussi des points communs très forts : un vrai rapport au visuel, des propositions très picturales, des images fortes, un vrai engagement corporel, qui ne laisse pas le public passif. Ce sont des propositions époustouflantes au sens premier, sensible, du terme. Des corps qui se mettent en péril, une physicalité extrême. Avant ça, j’avais une image du théâtre comme d’un art où l’on parle sans verser une goutte de sueur. Chez eux, non : ce sont des spectacles à la fin desquels tu n’en peux plus et tu es en nage.
Même s’il y a des choses que j’aime moins chez Rébecca Chaillon comme chez le Munstrum, leur travail m’a vraiment constitué en tant qu’artiste, avec des aspects qu’on retrouve dans mon spectacle : le visuel, le rapport à la performance, la relation avec la salle, certains codes de jeu…

YP : Quelle a été la genèse de ce projet ? Comment te sont venus à la fois ce thème de la prépa comme symbole du monde blanc, et l’esthétique du conte médiéval ?
AM : Ça a commencé comme une carte blanche quand j’étais en école supérieure de théâtre. Je voulais parler de mon expérience de la prépa, et que ce soit un voyage dans ma psyché, dans ce que j’avais vécu en tant que personne.Que les gens comprennent ce que c’est que d’être là où tu n’es vraiment pas à ta place, et ce à tous les niveaux. Je connais beaucoup de personnes racisées, qui ont arrêté et quitté ce monde, après avoir pourtant réussi. Une de mes amies a réussi le concours de l’École des Chartes, pour, une fois admise, s’y faire traiter de « sarrasine », ou d’« étrangère »… Elle est partie. C’est ça la réalité : on en part tellement on n’en peut plus.
En grandissant, j’ai tout appris de la culture blanche, mais les spectateur·ices blanc·hes ne connaissent rien, ou si peu, ou seulement des aspects très stéréotypés, de nos existences.
Au début le spectacle n’avait pas du tout cette forme, il reposait beaucoup plus sur des archives, était bien plus « premier degré ». De fil en aiguille, et grâce à des échanges avec mon assistant et ma dramaturge, on est arrivé à cette forme du conte. Elle me permet de prétendre à une forme d’universalité, de m’inscrire dans cette tradition médiévale, qui est une tradition extrêmement blanche et hétéronormée. Je cherche à en reprendre tous les codes, des codes avec lesquels j’avais grandi. En grandissant, j’ai tout appris de la culture blanche, mais les spectateur·ices blanc·hes ne connaissent rien, ou si peu, ou seulement des aspects très stéréotypés, de nos existences. La question que pose le spectacle à la fin est celle-là : je sais jouer à ce jeu, mais savez-vous jouer à mon jeu ?
YP : Et en même temps, il y a dans le spectacle une rupture de ton, et l’on sort du conte…
AM : On est dans une période tellement apocalyptique que, pour moi, on arrive à un point où la fiction ne suffit plus. Même si le rêve et la fiction jouent un rôle important dans la pièce, j’avais besoin qu’à la fin les choses soient dites explicitement. De la même manière que ça ne fait plus sens pour moi de faire comme si le public n’existait pas. Sa présence est une opportunité incroyable de dire certaines choses, alors je saisis cette opportunité.
La première partie, très fantastique, est quand même très proche de moi : enfant, je me suis réfugié dans tous ces récits. J’ai regardé beaucoup d’anime, de films, de séries, j’ai énormément joué aux jeux vidéo. C’était obsessionnel. Je chéris encore ça.
YP : Dans cette culture populaire, s’agissait-il encore de modèles blancs ?
AM : C’est intéressant parce que justement ce n’est pas le cas. Rokhaya Diallo, dans une interview passionnante à la chaîne Histoires Crépues, parle du fait qu’elle a regardé des milliers d’anime quand elle était jeune. Elle a même été cofondatrice de la Japan Expo ! Elle raconte que dans les mangas, les récits sont tellement extrêmes, éloignés de la réalité, qu’il est plus facile de s’y identifier, même si les personnages sont blancs. Ces récits étaient donc plus proches de moi que des œuvres de la culture légitime, comme Peau d’Âne, par exemple. J’adore Jacques Demy, mais il n’y a pas un seul personnage noir, pas un ! Même dans un rôle ultra-secondaire. Néanmoins, j’ai toujours aimé ses films : c’est une ambivalence que je conserve, et que je questionne dans le spectacle. J’ai grandi avec un discours dominant qui nous disait : « voilà ce qu’est la culture, vous n’en faites pas partie. La culture qui est la vôtre se résume à quelques grandes figures comme Nina Simone ou Aimé Césaire. » Des figures qui doivent être parvenues au zénith de leur art pour qu’on en parle. Alors qu’il y en a tellement d’autres. Le spectacle parle beaucoup d’archives perdues et d’histoires pas transmises. C’est pour ça qu’à chaque représentation j’évoque des nouvelles personnes noires qui m’ont influencé. Si les gens reviennent voir le spectacle, ils n’entendront pas les mêmes anecdotes, repartiront avec des références différentes.

YP : Le titre est assez énigmatique…
AM : « Quand on dort on n’a pas faim » est une phrase que ma mère me disait tout le temps. Elle trottait dans ma tête comme une incantation, et elle prend une résonance folle avec le contenu du spectacle : j’ai l’impression qu’on m’a beaucoup endormi, raconté des histoires à dormir debout. Quand tu te réveilles, c’est un aller sans retour. Et tu as faim ! Le personnage de Paris Ardant parle de cela au début : ce n’est pas possible de se nourrir uniquement de songes, il faut croquer la vie. J’ai passé énormément de temps à manger du vide, à me nourrir de fantasme. C’est un état de refoulement, et quand tu soulèves le couvercle, c’est vertigineux.
YP : Le spectacle évoque deux éveils, un éveil à la sexualité queer et homosexuelle, et un éveil au racisme.
AM : Oui, cette agression raciste que j’ai vécue en prépa et qui m’a fait me rendre compte de la façon dont les gens me voyait. Évidemment tout le monde n’est pas raciste à ce point-là, mais tu restes encore et toujours la personne noire de la photo. Bien qu’en réalité, dans ma classe, nous étions trois. C’est quelque chose que j’avais oublié. Je n’étais en théorie pas seul. Sauf que sur les deux autres, l’une disait qu’elle n’était pas noire ; et avec l’autre nous n’étions pas en lien, pas sur ces questions-là. Il n’y avait pas de soutien.
Est-ce qu’il ne serait pas temps d’inventer ses propres rêves et d’arrêter de rêver avec des représentations dans lesquelles tu n’as pas ta place ?
Le spectacle interroge la question du rêve depuis cette perspective : tu rêves un rêve qui n’est pas fait pour toi, qu’on t’a donné, qu’on t’a inculqué, mais dans lequel tu n’as pas ta place. Est-ce qu’il ne serait pas temps d’inventer ses propres rêves ? Et d’arrêter de rêver avec des représentations dans lesquelles tu n’as pas ta place ? Même le cadre du conte médiéval est remis en cause selon cette logique.
YP : Pour quelles raisons as-tu choisi d’être maquillé en blackface ? Est-ce une manière de détourner les représentations racistes qui ont longtemps été les seules représentations de personnes noires au théâtre et au cinéma ?
AM : Il y a tout d’abord la dimension qui consiste à reprendre le stigmate pour se le réapproprier, qui est un geste assez courant. Mais c’est un blackface augmenté, qui annonce l’esthétique de la pièce. Il y a des paillettes, il évoque l’univers queer et drag d’où je viens. C’est la même chose avec le costume du bouffon qui est augmenté avec les longs ongles rouges, les épaulettes, les talons… C’est très drag, et c’est un indice sur le propos de la pièce : je vais jouer à votre jeu, mais avec mes codes.
Je joue à pousser certains curseurs au maximum, ici en l’occurrence ma race et ma peau, comme si je cherchais à exprimer encore plus l’inadéquation : comment cette personne a-t-elle cru une seule seconde qu’elle pouvait appartenir à cet univers, chromatiquement, avec sa tête si noire ? La pièce est too much à plein d’endroits, je suis dans l’exagération. C’est du théâtre.
YP : Tu n’es pas seul au plateau, mais tu es accompagné de ta sœur Mérèndys Martine, qui est aussi une personne queer. Elle signe également les costumes du spectacle. Quelle est votre relation ?
AM : C’est ma petite sœur. Nous n’étions pas proches du tout jusqu’à très récemment, il y a quelques années seulement. Maintenant, pas un jour ne passe sans qu’on ne s’écrive. Le spectacle évoque cela : ma sœur est là tout du long, à tisser notre lien, mais je ne la vois pas. C’est dingue de se dire qu’on a vécu des choses aussi similaires, qu’on était à côté l’une de l’autre et qu’on ne le savait même pas. C’est vertigineux de penser à tout ce qu’on aurait pu s’épargner s’il y avait eu plus de communication. On est quand même deux personnes queers dans la même famille ! Ce que nous avons est unique, et c’est aussi unique de pouvoir partager la scène avec elle.
YP : Tu parlais de ce que c’est d’être une personne noire dans le monde blanc qu’est la prépa. Mais qu’est-ce que ça fait d’être une personne noire dans le monde de blancs qu’est le théâtre en France aujourd’hui ?

AM : Ah, ce sera le sujet du prochain spectacle !(rire) La fin de Quand on dort on n’a pas faim tend déjà un peu vers ça. En fait, c’est un peu différent, car le théâtre public est un milieu qui se pense très de gauche, ce qui n’est pas le cas de la prépa Henri IV. Aujourd’hui, une grande angoisse de beaucoup de personnes dans le milieu du théâtre est de se faire « call out », comme on dit. Donc certains sujets sont mis en avant, mais pas à partir d’une conviction réelle et vécue, seulement parce que c’est tendance, qu’il faut le faire, et qu’on n’a pas envie de se faire call out. Alors que le théâtre est un monde sur la sellette et qu’on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé en 2027. Avec ce spectacle, j’ai la sensation de me dire : pour l’instant je peux faire ça. Mais je sais très bien qu’on est toujours en danger, qu’à partir de 2027, au moindre truc, si les gens peuvent ne plus se mouiller, ils ne se mouilleront pas. Il y en aura quelques uns qui continueront, mais c’est tout. Déjà maintenant, à propos de certains spectacles comme par exemple Plutôt vomir que faillir de Rebecca Chaillon, certains programmateurs sont extrêmement frileux. On entend des choses comme « c’est trop », « ce n’est pas pour notre public », « ce n’est pas une bonne idée, dans le contexte actuel… » Alors que peut-être que c’est maintenant ou jamais, justement.
Les logiques racistes sont donc tout autant présentes dans le théâtre public qu’ailleurs, mais par contre c’est un monde dans lequel j’ai aussi eu plus de soutien. Je ne suis pas à plaindre : je suis programmé, j’ai des financements de la DRAC… Donc j’essaie de tout donner.
Pour aller plus loin – recommandations de lecture par Anthony Martine
La charge raciale, Douce Dibondo (Fayard, 2024)
Écrits pour la parole, Leonora Miano (L’Arche, 2023)
Johnny, est-ce que tu m’aimerais si j’avais une plus grosse bite ?, Brontez Purnell (Rotolux Press, 2024)
Afro Trans, Michaëla Danjé (Cases rebelles, 2021)
À écouter
« Le théâtre, un truc de blancs ? » (Podcast Dramathis, S3 E7, Mathis Grosos)
Quand on dort on n’a pas faim
Écriture et mise en scène – Anthony Martine
Avec – Anthony Martine et Mérèndys Martine
À voir au Théâtre 13/Glacière (Paris), du 1er au 11 octobre 2025.
Prochaines dates
15 et 16 octobre – TU Nantes
9 avril 2026 – Université Sorbonne-Nouvelle, Paris
Makbeth
d’après William Shakespeare
Mise en scène – Louis Arene
Une création du Munstrum Théâtre
Avec – Louis Arene, Sophie Botte, Delphine Cottu, Olivia Dalric, Lionel Lingelser, Anthony Martine, François Praud, Erwan Tarlet
Prochaines dates
5 au 7 novembre – Malakoff, Scène nationale
12 au 14 novembre – Théâtre Varia, Bruxelles
20 novembre au 13 décembre – Théâtre du Rond-Point, Paris
5 et 6 mars 2026 – Le Carreau, Scène nationale de Forbach et de l’est mosellan
11 et 12 mars – MC2: Grenoble
Lire notre critique de Quand on dort on n’a pas faim.
Découvrir tous nos Entretiens.