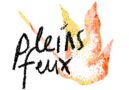Pleins Feux s’attarde aujourd’hui sur un objet étonnant du Festival OFF d’Avignon, un ovni théâtral et musical qui joue avec l’enregistrement en direct, le son et la performance vocale : C’est mort (ou presque) au Théâtre du Train Bleu, basé sur les textes du poète et performeur Charles Pennequin, avec l’impressionnant multi-instrumentiste Joachim Latarjet. Cette proposition ouvre un champ de réflexion très fertile sur le rapport au texte et sur l’imaginaire déployé par le son, qui ouvre un autre rapport à la théâtralité.
« Des fêtes dans la tête »
C’est un drôle d’ovni qui nous attend ce jour-là dans la petite salle du Train Bleu. Joachim Latarjet prend à bras-le-corps la proposition poétique du poète et performeur Charles Pennequin qui ouvre le spectacle : « J’ai très vite pris le pli de composer mes textes dans ma chambre et d’imaginer des concerts inoubliables dans ma tête, car je peux créer ainsi une symphonie pour moi seul dans ma tête, et je suis très ému d’être l’unique public de ce chef-d’œuvre qui n’est jamais sorti de ma tête. » Et c’est ce « dans ma tête » qui guidera tout le spectacle : en effet, il se dégage de la performance de Joachim Latarjet l’impression d’assister à quelque chose d’assez secret, un de ces moments de débordement intérieur que l’on vit seul, comme on danserait follement sans se juger ou comme on chanterait à tue-tête sous la douche. Entouré de sa batterie de micros, pédales de loop et instruments variés (guitare électrique, banjo, trombone, tuba, petit clavier), le musicien nous semble véritablement « dans sa chambre », au sens poétique du mot : dans un petit espace clos et propre à lui, où toutes ses obsessions et ses pensées viennent rebondir contre les quatre murs fictifs. Dans ma chambre/ dans ma tête, au fond c’est un peu le même endroit.
Petite histoire

Le musicien nous expose assez tôt le code qui va être le sien, grâce à une phrase de Charles Pennequin qui ouvre le spectacle : « Plus ça se dit, plus c’est vivant ». Aussitôt dite, la phrase sera déformée, remplie d’échos, rythmée, multipliée, accompagnée d’une pulsation qui déforme le sens et le reconstruit sans cesse, tandis que Joachim Latarjet gratte sa guitare. La répétition deviendra le motif principal de la performance, au sens littéral – présence des loopers qui bouclent à l’infini les séquences musicales et les mots – et au sens figuré : on sent derrière cette espèce de délire secret qui nous est offert une certaine urgence à dire quelque chose avant la fin, à dire des mots qui n’ont pas été dits, peut-être pour ne pas mourir justement. « La répétition, c’est ça qui fait la vie ».
Joachim Latarjet oppose cette étrange cérémonie à une chose douloureuse qui se dévoile parfois au détour d’une phrase.
Il y aurait presque quelque chose du mantra derrière tout ça, psalmodier pour lutter contre la mort, le silence, opposer cette étrange cérémonie et ce bloc de langage à une chose douloureuse qui se dévoile parfois au détour d’une phrase : « tu ne m’as pas encore tué, cette fois, mon petit papa ». La figure de l’ogre louvoie dans les mots scandés ; le « petit papa » revient à plusieurs reprises, sous la forme d’un homme qui boit, un « paumé qui prend le bus ». « Nous étions la petite histoire », scande le musicien. La petite histoire n’a pas toujours de mots pour se dire, le petit papa ne parle pas. Pour percer cette couche de silence accumulé, il faut toute la force d’un langage compact, amplifié par les compositions de Joachim Latarjet qui élargissent le cœur et les murs.
La parole magique
C’est dans l’énergie du verbe couplée à celle de la musique que semble se livrer l’ultime combat contre la mort.
Dans ce rituel bizarre, où les couches de son et de sens s’additionnent sans jamais offrir de solution et sans conclure, Joachim Latarjet parle sans attendre de réponse ; ce qui lui parvient n’est que l’écho de ses propres boucles musicales qui s’empilent et tourbillonnent ensemble, et il joue avec le code même de sa performance en faisant parfois intervenir d’autres voix que nous ne l’avons pas vu enregistrer devant nous, et qui mystérieusement s’additionnent à l’ensemble. « C’est à qui de parler là ? C’est à qui de prendre la parole ? » demande le musicien. Dans ce processus hypnotisant qui tient presque de la transe parfois, de cette étrange transe que peuvent provoquer certaines longues improvisations de jazz, il y aurait sans doute matière à réveiller les morts… Et si les mots de Charles Pennequin posent des questions graves sur le rapport de la parole avec les mystères de notre présence au monde – « Comment faire taire cette existence qui ne nous amène qu’à mourir ? » – c’est dans l’énergie du verbe couplée à celle de la musique que semble se livrer l’ultime combat contre la mort. Et nous, public étonné d’être invité à ce rituel de conjuration, nous pourrons danser aussi secrètement sur nos sièges du Train Bleu, et déployer nos fêtes intérieures.
C’est mort (ou presque)
Un spectacle conçu et interprété par Joachim Latarjet – Cie Oh ! Oui…
Textes – Charles Pennequin
Mise en scène – Joachim Latarjet, Sylvain Maurice
Composition et interprétation – Joachim Latarjet
Régie son – Tom Ménigault
Production – Marie Ben Bachir
Au Théâtre du Train Bleu – Avignon, du 3 au 21 juillet à 18h40.
Tournée 2025-2026 : 23 septembre-4 octobre au Théâtre de l’Athénée (Paris), 17-18 décembre au Théâtre Jean Vilar (Montpellier), 6-7 janvier 2026 à l’ACB-Scène nationale de Bar-le-Duc, 27-29 janvier aux 2 Scènes (Besançon), 12-13 mai au Quartz (Brest).
Lire nos derniers articles sur le festival d’Avignon :
Ouverture : Chemin de douceur, expérience mystique
Du cirque à Villeneuve en scène : poétique de l’insécurité
Un soir chez Boris : le vertige du trappeur
Pour retrouver tout le festival d’Avignon 2024 sur Pleins Feux, c’est par ici.