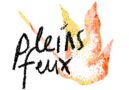Dans l’écrin de beauté du cloître des Carmes, Israel Galván et Mohamed El Khatib nous présentent leur duo éponyme : Israel & Mohamed. Le premier, Israel Galván, est un danseur virtuose de Flamenco, le second, Mohamed El Khatib, est un auteur, metteur en scène et réalisateur incontournable. Ensemble, ils composent une « danse documentaire » pour exprimer par les mots, la danse et tout ce qui se trouve entre les deux, l’histoire qu’ils entretiennent avec leurs pères.
Des pères envahissants par leur absence
Une fois que les trompettes de Jean Vilar finissent de retentir, marquant le début de la représentation, les deux interprètes Israel Galván et Mohamed El Khatib entrent tout de suite en scène. Mohamed est vêtu d’un maillot jaune où l’on peut lire « Tanger, Morocco », d’un short de sport et de chaussures de flamenco. L’autre, Israel Galván, revêt une djellaba bleu clair, qu’on apprendra être celle du père de Mohamed, des bas noirs et des bottines blanches à talons. Ainsi habillés, ils procèdent à une pantomime d’échauffements de footballeurs, traversant la scène de cour à jardin et de jardin à cour, nous adressent des mimiques et des gestuelles codifiées. Cette image bien que désordonnée est pourtant très construite. Si le football est ainsi représenté c’est qu’il lie les deux hommes. Mohamed a arrêté une carrière professionnelle et Israel n’a jamais pu commencer la sienne, empêché par son père. Le spectacle parlera donc de leur trajectoire de vie, de la déception de leurs pères et des rencontres que les solitudes peuvent provoquer.
Les pères sont présents partout sur le plateau. De part et d’autre de la scène, deux autels sont dressés pour les patriarches. À Jardin, celui du père de Mohamed avec des exemplaires du Coran, des tapis de prière, des babouches et une photographie de lui. À cour, celui du père d’Israel avec une représentation du paradis fait de Playmobils, une peluche perroquet et un portait encore. Les objets sont apportés sur l’autel avec le souvenir qui y est associé, parfois heureux, souvent amère. Nous découvrons ces pères d’abord par les objets et les lourdes histoires qu’ils renferment, puis, deux écrans projettent des interviews d’eux au sujet de leur fils respectif. Ils sont très libérés dans leurs paroles, désapprouvent très ouvertement les carrières de leurs enfants : l’un parce que le théâtre n’est pas un métier, l’autre parce qu’il ne danse plus le flamenco dans sa stricte tradition. Ces pères sont partout si ce n’est dans la salle du spectacle qui leur est adressé.
Pourtant, la magie du cloître des Carmes, du spectacle, du je-ne-sais-trop-quoi a opéré ce soir-là. Tandis qu’Israel prend la parole brièvement -la danse étant son moyen de communication privilégié – pour parler de son père, l’autel de ce dernier, est poussé par le vent et se retrouve dirigé vers le centre, le regard de la photographie posée sur son fils. Une absence, peut-être, mais qui met en mouvement.
Une absence, peut-être, mais qui met en mouvement.

Comment dire les choses ?
Chacun des interprètes racontent ce lien trouble et complexe qu’il entretient avec son père selon son art. On retient notamment d’Israel Galván, danseur prodige, cette sublime scène avec son collier de médailles. Son père l’a poussé a ce qu’il devienne danseur professionnel, au point d’en crever ses ballons de football pour s’assurer qu’il se concentre sur la danse. Aujourd’hui Israel a une immense carrière qui a particulièrement décollée lorsqu’il a modernisé le flamenco avec une gestuelle qui lui est propre, s’écartant ainsi de l’enseignement traditionnaliste de son père. Il fut ainsi récompensé par une ribambelle de médailles, amenées sur scène. Le danseur passe à son cou toutes ces médailles avant de danser un solo de flamenco vibrant, où le cliquetis de l’or plaqué, alourdi mais également complète la rythmique. Il danse la fierté, l’emprise, la perte, le vertige, la liberté, il se danse lui.
Mohamed El Khatib lui, se raconte par les mots et sa maitrise grisante du symbolisme. Ses textes ont un dosage parfait, comme une excellente pâtisserie, avec ce qu’il faut de rire, de vérité, de sanglots, de lumière, de politique et de poésie. Il dit qu’il a appris le « Coran par les mains », puisque son père lui frappait les doigts quand il se trompait. Son père parle avec les mains plutôt que par mots. Mais Mohamed lui écrit malgré tout une lettre, qu’il nous lit à nous, étranges témoins de cet amour désavoué mais pourtant sincère.
Est-ce grâce au théâtre qu’ils osent enfin dire ce qui les habite ? Mais en nous conviant, n’y-a-t-il plus aucune chance que leur père osent un jour écouter leur histoire ? Est-ce une confidence ou un ultime pied de nez ? Et surtout, pourquoi sommes-nous touchés comme nous le sommes ?
Nous sommes les étranges témoins de cet amour désavoué mais pourtant sincère.

Tisser des liens
Les interprètes sont dans une belle qualité qui les rend poreux au monde. Ils sont comme des catalyseurs de l’aveu.
Tout au long du spectacle, le ton sera léger, simple, les transitions sont ce qu’elles sont. Si le plateau est vide alors il est vide. Les interprètes sont dans une belle qualité qui les rend poreux au monde. Ils sont comme des catalyseurs de l’aveu. Les artistes sont détendus, sincères, la confidence toujours au bord des lèvres.
Presque immédiatement, la salle adhère. Elle rigole des anecdotes joyeuses, rigole aussi des moments trop cruels. Le premier rire est un rire d’écoute, le second de sidération. Même si on n’a pas grandit en dansant des Seguiriya, ou en évitant des lancés de babouches, on comprend tout ce qui se dit. Le « on ne peut plus spécifique » est en réalité emprunt d’universel. Ce spectacle crée des liens complices avec la salle qui sera le regard aimant, encourageant, qui leur a fait défaut.
Mais Israel & Mohamed, c’est aussi ce duo inexplicable que tout oppose à bien des plans et des égards, et qui pourtant fonctionne en toute évidence. Dans un entretien, ils racontent leur rencontre à Paris en décembre 2023 alors qu’Israel Galván s’est déchiré les ligaments croisés. Mohamed El Khatib explique : « Le paradoxe de notre lien, c’est la rupture de nos ligaments. Je me suis aussi déchiré les ligaments des deux genoux, d’abord le droit puis le gauche. Nous n’avons plus de ligaments mais notre rencontre nous permet d’en recréer de nouveaux, ensemble.«
Israel & Mohamed semblent être deux noms inconciliables. Parfois, ils sont même contraints de changer le prénom d’Israel lorsqu’ils jouent dans certains pays, pour se protéger. Mais le sublime du spectacle réside dans ce « & », ce nœud de marin, ce petit bretzel, ce lien qui nous rappelle qu’aucune rencontre n’est impossible. Les pères ne sont peut-être pas dans la salle, mais il s’y trouve la reconnaissance émue et chaleureuse d’un public obligé.

Israel & Mohamed
Avec Mohamed El Khatib et Israel Galván
Conception Mohamed El Khatib et Israel Galván
Scénographie Fred Hocké
Vidéo Zacharie Dutertre, Emmanuel Manzano
Son Pedro León
Costumes Micol Notarianni
Direction technique Fred Hocké, Pedro León
Construction Pierre Paillès, Géraldine Bessac
Production Rosario Gallardo, Gil Paon
Au cloître des Carmes jusqu’au 23 juillet, dans le cadre du Festival d’Avignon
Prochaines dates
10 au 20 décembre – Théâtre de la Ville, Paris
Tous nos articles sur le Festival d’Avignon
Tous nos articles Danse.