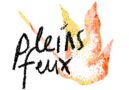“We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep” disait le mage Prospero dans La Tempête. De sommeil, de rêve et de tempête, il sera aussi question dans La grande marée, dernière création de Simon Gauchet présentée au Théâtre de la Bastille, alors que les acteurices nous attendent endormi.e.s à même les planches du théâtre-navire – rêvant sans doute de visions extraordinaires et d’îles englouties. Le metteur en scène de L’expérience de l’arbre et son équipe (ou plutôt équipage, devrions-nous dire ?) nous invitent en effet à embarquer avec eux pour suivre l’idée un peu folle d’un groupe de philosophes allemands de la fin des années 80 : partir en bateau à la recherche de l’Atlantide, ce royaume mythologique submergé dans un déluge immémorial. Une entreprise complètement intempestive, à contre-courant de la modernité dominante, ainsi que la décrit un des comédiens.
Une quête métaphysique
Alors que les acteur.ices s’éveillent, et font le récit de leurs rêves – rituel quotidien de la création du spectacle nous disent-iels –, puis nous dévoilent les origines du spectacles, sa généalogie, nous comprenons que la quête sera (au moins) triple : géographique, philosophique et dramaturgique. En effet, le spectacle se présente comme un mille-feuilles psycho-physique – et de la même manière qu’Ulrich Sonnemann et Dietmar Kamper, les principaux protagonistes de cette expédition finalement inaboutie, la définissent comme une tentative de vaincre l’oubli et de remonter aux origines du traumatique refoulé pour mieux faire face aux catastrophes historique et individuelle du XXe siècle, la troupe retraverse devant nous toutes les strates de la pièce en train de se jouer, qui se déplient au sens figuré et au sens littéral.

Au figuré, car le récit enchâssé articule différents niveaux de discours aux traces de moins en moins solides : le moment présent de la représentation elle-même, un article resurgi de la critique de théâtre Brigitte Salino, la reconstitution scénique d’un entretien avec Dietmar Kamper (que troublent problèmes d’enregistrement et éternelle inexactitude de la traduction), et les souvenirs de ce dernier rejoués sous nos yeux. Et au sens littéral, car l’espace scénographique est investi de grandes toiles peintes d’opéra, lesquelles, manipulées à la main par les acteur.ices à l’aide de fils et de poids comme s’ils actionnaient les voiles d’un trois-mât, figurent avec une irradiante intensité les flux et reflux de la marée, le sol de plaines marines, les parois de grottes préhistoriques, bref toute une carte du monde qui se fait et se défait.
Potentiel poétique et aveu d’impuissance
En résulte un spectacle de deux heures au moins aussi ambitieux que l’expédition dont il s’inspire, qui essaie de brasser dans cette épopée historico-fantastique une multitude de thèmes et de références au risque de déborder. Ainsi, la recherche de l’Atlantide étant comprise comme une quête des origines, aussi bien à l’échelle de l’individu que de l’espèce, c’est donc aussi une réflexion sur le fonctionnement de la mémoire qui nous est proposée (“Essaie de te souvenir, ou à défaut invente”), celle-ci se doublant d’une interrogation esthétique sur le problème de la représentation ( “Toute image est une présence de l’absence” ), et d’une discussion entre psychanalyse et philosophie sur le retour du refoulé et la catastrophe du nazisme.
Le tout en sautant de caves métaphoriques en boîtes de nuit berlinoises, des landes mégalithiques bretonnes aux récifs de Santorin, convoquant aussi bien Baptiste Morizot – sur notre passé d’êtres spongieux nostalgiques d’avoir quitté les océans –, que le Prélude aux suites pour violoncelles de Bach (écho de la chute du Mur) et sa cantate Aus der Tiefe (des profondeurs, je t’appelle…). Cette accumulation de couches textuelles et dramaturgiques provoque moins l’impression recherchée d’un gouffre où l’on se perd que celle d’un empilement qui laisse trop peu de place à l’imaginaire.
La forme proposée par Simon Gauchet frustre plus qu’elle émerveille, en renonçant à la sublimation que permettrait la fiction et l’imaginaire.
Plus décevant, le spectacle pêche par excès de discours méta-théâtral. Alors même qu’un des philosophes s’exclame qu’il faut sortir du théâtre et des universités, tout dans La grande marée semble nous y ramener, tant la pièce s’abîme en permanence dans le récit de sa propre création et l’analyse de son propre geste. L’explicitation constante, frontale, et premier degré annihile complètement le contenu poétique potentiel (pourtant très grand au vu des sujets traversés) – et cela sonne comme un étonnant aveu d’impuissance. Alors même que l’histoire exalte la puissance d’évocation des images et le pouvoir d’attraction du mystérieux, la forme proposée par Simon Gauchet frustre plus qu’elle émerveille, en renonçant, à quelques passages près, à la sublimation que permettrait la fiction et l’imaginaire.
Ainsi, les rares moments du spectacle où ce discours analytique et rétrospectif laisse la place à une véritable proposition scénique, des moments de grande beauté se font jour. C’est le cas à chaque apparition/disparition des toiles peintes, quand les acteurices munis de casques et de frontales jouent furtivement les spéléologues et traversent les murs de la grotte, quand un des comédiens crée au micro le son de la tempête tel un dieu grec manipulant le climat, quand iels écrivent à l’eau à même le mur du théâtre comme en écho lointain aux peintures pariétales… Ou encore quand une des comédiennes s’enflamme en reprenant l’histoire de l’héroïne d’un opéra de Gounod.
Passionnant par son ambition, mais décevant dans l’exécution, La grande marée nous laisse en se retirant un goût de sel dans la bouche… mais également la promesse d’autres aventures à venir, tout aussi captivantes. A n’en pas douter, Simon Gauchet et son équipe en sont plus que capables.

La Grande Marée
Mise en scène de Simon Gauchet
Avec Gaël Baron, Yann Boudaud, Rémi Fortin et Cléa Laizé
Vu le 10 novembre 2023 au Théâtre de la Bastille