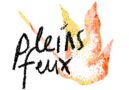Au Théâtre 13, dans le cadre du festival Impatience 2024, qui met en avant la vitalité du théâtre émergent, Cécile Morelle et la cie Le Compost présentent La Trouée, road-trip rural. Une pièce intime et documentaire, en forme de podcast pour tous les sens, qui entremêle les témoignages de femmes paysannes et le retour aux sources de Cécile dans le monde rural de son enfance.
D’où venez-vous ? Où êtes vous né·e ? C’est par ces simples questions adressées à des membres au hasard du public que Cécile Morelle ouvre La Trouée, road-trip rural, son seule en scène présenté au Théâtre 13 dans le cadre du Festival Impatience. Avec sa longue perche de prise de son, elle se présente à nous comme une intervieweuse de radio qui discute avec ses interlocuteur·ices, désireuse de connaître ce qui les rattache à leurs racines. Elle instaure ainsi immédiatement un rapport de familiarité avec la salle, qui avant même que le récit commence, est séduit par l’écoute et la présence de Cécile Morelle. « Y a-t-il une odeur qui vous ramène directement à l’enfance ? » : c’est par les sensations que Cécile nous accroche, et c’est par les bruits qu’elle nous fait entrer dans la campagne, dans sa mémoire d’enfance de campagne, recréant l’espace de la ferme par le son : ici les pintades qui glougloutent, là le bruit métallique des stabulations, ou encore le ronron de la pailleuse.
Entrée dans la campagne par les sens

La Trouée est l’histoire de Cécile, petite-fille de paysanne, une histoire de retour à la campagne. Quand la vie urbaine perd son sens, un jour où elle trébuche physiquement et métaphoriquement, où elle s’empierge comme le fait entendre le patois qui refait surface, elle prend subitement la route. « Est-ce que le chez-moi de l’enfance est encore chez moi ? » se demande-t-elle. Et de répondre : « Il faut que je creuse la question. » Ainsi, cette échappée en voiture, jusqu’à trouver le chemin au bout duquel il y a une ferme, dans laquelle il y a un champ, où bout duquel il n’y a plus rien. Et se demander si ce rien, ce trou n’est pas effectivement plein de vie. Dans ce trou, il y a les parents bien sûr, le père mutique et la mère qui se plaint d’être éloignée de tout, il y a les souvenirs douloureux de l’adolescence et il y a la ferme de Mémé Mado, celle où la jeune Cécile rappait sur le bruit de machines de la salle de traite.
Au commencement il y a des routes, et au bout des routes, il y a les fermes.
Raymond Depardon
La Trouée est avant tout une pièce de sensations, vectrices de souvenirs si efficaces, qui réussit terriblement bien à nous faire ressentir la matérialité et l’organicité de son propos.
Cette phrase, Cécile l’écrit avec de la terre en guise d’encre, sur un grand tableau blanc au plateau – la jetant par poignée sur les lettres déjà tracées à la colle. Ingénieuse scénographie où la phrase semble sortir de terre, où l’humus constitue la matière au sens littéral du texte, comme il l’est au sens métaphorique. Le spectacle fait appel à tous nos sens : le son bien sûr, mais aussi le toucher, face à ce tas de terre moelleuse et grasse, dans laquelle une Cécile à moitié chien creuse un trou pour y enfouir sa tête. Et l’odorat, bien sûr, par qui passe l’essence de la campagne : « L’odeur, c’est ça qui fait le charme. Si y a pas une bonne odeur de fumier, c’est pas une bonne campagne. ». La Trouée est donc avant tout une pièce de sensations, vectrices de souvenirs si efficaces, qui réussit terriblement bien à nous faire ressentir la matérialité et l’organicité de son propos.
Une parole collective
Dans une veine documentaire toujours incarnée mais jamais niaise ou didactique, ces voix données à entendre successivement peignent une image concrète du métier et de la vie de fermière.
Mais le retour aux sources de Cécile n’est pas vraiment un road-trip égocentré. La Trouée est aussi pleine des témoignages d’autres femmes paysannes, que Cécile a rencontrées et interrogées dans son périple. Dans une veine documentaire, façon podcast intime, toujours incarnée mais jamais niaise ou didactique, ces voix données à entendre successivement peignent une image concrète du métier et de la vie de fermière, loin des idées reçues. Si c’est « un métier de renfrognée » dans lequel on ne montre pas ses sentiments, les questions de Cécile viennent doucement déterrer les confidences de ses interlocutrices.
C’est Anaëlle, éleveuse avec son frère, qui dit « on fait » quand elle est dans la cuisine avec son vieux père, mais « je fais » dès qu’elle est dans son étable. C’est Chiara, paysanne-boulangère en devenir, victime de la xénophobie et du mépris des chasseurs de son village, qui a décidé, pour s’intégrer, de parler moins avec les mains et de vendre des pizzas. C’est Emilie, maraîchère en Bretagne qui s’est enfuie à 18 ans avant de revenir après un burn-out, et confrontée au suicide paysan, dont on parle encore trop peu. Et ce sont « Les pipelettes », ce groupe de parole entre agricultrices monté par Anaëlle, dont nous écoutons les débat croustillants illustrés par les animations d’Edouard Peurichard. Ces paroles de femmes qui racontent le sexisme du milieu dans les formulaires administratifs genrés ou dans l’omniprésence un père retraité mais qui se croit encore chez lui.

Tous ces témoignages récoltés par Cécile Morelle sèment en elle la redécouverte de son identité.
Et tous ces témoignages récoltés par Cécile Morelle sèment en elle la redécouverte de son identité : celle-ci, son « paysage », son « origine du monde », c’est bien sûr la ferme de mémé Mado, dans la Picardie plate froide grise. La phrase de Depardon est réécrite, les routes deviennent des plaines, la terre dessine désormais un paysage rural sur le tableau. Les stries des chips « recette paysanne » deviennent les sillons des labours. Et la trouée devient la bouche de Cécile qui déverse dans ce long monologue final, sensible et germé d’images, tout son amour pour Mado, celle qui voit dans le passage quotidien de ses vaches un paysage sans cesse renouvelé, et tout son attachement pour ce pays, ses grandes plaines, ses habitants, son parler, ses vies.
Riche et émouvant, La Trouée : road-trip rural sent la terre et le fumier, et est donc un bon spectacle, et mieux encore : captivant dans sa dramaturgie plurielle et dans sa mise en scène sensitive, on ne peut qu’y adhérer, comme la terre qui colle à la peau. Passé par le Train bleu au festival off d’Avignon 2023, sa sélection pour cette édition du festival Impatience marque le talent indéniable de Cécile Morelle qui, il n’est pas permis d’en douter, a certainement réussi à faire son trou.
La Trouée
Texte, jeu et mise en scène – Cécile Morelle
Co-mise en scène – Chloé Duong, Édouard Peurichard
Collaboration à la mise en rue – Christophe Chatelain
Collaboration à la dramaturgie – Anne Marcel et Fred Billy, Marie Vayssière et Chloé Duong
Regard chorégraphique – Édouard Peurichard, Valérie Oberleithner et Marie-Pierre Pirson
Vidéo-animée – Édouard Peurichard
Photographie – Lucile Corbeille
Illustration – Philippine Brenac
Décors – Albert Morelle
Son – Arthur de Bary
Lumière – Leslie Sozansky, Luc Degassart
regards précieux – Paola Rizza, Alexandre Del Perugia, Annabelle Sergent, Olivier Tirmarche
Production – Natacha Thaon Santini
Vu le 11 décembre 2024, au Théâtre 13, dans le cadre du Festival Impatience.
Prochaines dates
4 février 2025 – Méru (60)
8 février – Théâtre de la Genette Verte, Florac (48)
11 février – Théâtre de Cusset (03)
6 mars – Maison de la Culture et Loisirs de Gauchy (02)
24 au 29 mars – L’Ernée (53)
1er et 2 avril – Théâtre Le Rayon Vert Scène conventionnée d’intérêt national Art en territoire – Saint Valéry en Caux (76)
13 mai – Théâtre Le Strapontin – Pont Scorff (56)
15 mai – CC Mont Saint Michel – Avranches (50)
23 et 24 mai – Le Safran, Amiens (80)
Nos autres articles sur le festival Impatience 2024 :
Sans faire de bruit : la voix des aimé·es