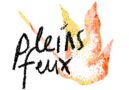C’est la troisième fois que le festival d’Avignon accueille une création de Samuel Achache. Après Fugue en 2015 et le grand succès de Sans Tambour en 2022, nous découvrons cette année Les Incrédules, et le festival ouvre les portes de son opéra du centre-ville sur la place de l’Horloge. La troupe de Samuel Achache y déploie les grands moyens : habituée des formes musicalo-théâtrales novatrices, cassant les codes de genre et les frontières entre les arts, elle se confronte pour la première fois au défi de présenter un véritable opéra.
Tout contre l’opéra
Le petit lutte avec le grand, le réel avec le transcendant : vais-je m’abandonner et finir par croire ?
Mais qu’est-ce que c’est, au fond, un opéra ? Les amoureux·ses des créations de la troupe d’Achache pourraient être surpris·es du gigantisme de la forme et de certains impératifs du style auxquels l’équipe de création ne coupe pas. Si celle-ci nous avait habitué·es à questionner et jouer avec les codes notamment opératiques, en donnant par exemple dans Le Crocodile Trompeur une version déconstruite-reconstruite de Didon et Enée de Purcell, ici il est tout de même question de jouer le jeu. Dans Les Incrédules, il y a 52 musicien·nes en fosse (l’orchestre de l’opéra de Nancy), un chef d’orchestre (le sensible Nicolas Chesneau), des chanteur·ses lyriques, et une écriture musicale savante, colorée, puissante, qui pourrait avoir un parfum de Poulenc, signée par les géniaux Florent Hubert et Antonin Tri Hoang. Bien sûr, la touche Achache est toujours présente : sur scène, les rôles chantés sont doublés par des rôles parlés qui se superposent, et l’orchestre en fosse répond à un petit orchestre de plateau plus en phase avec le rythme de l’action, qui se déplace au gré des tableaux, en jouant par cœur, et en s’asseyant sur tous les coins de décor possibles (cartons de déménagement, prie-dieu, civière).
C’est que par nature le temps du chant est plus lent que le temps de la parole : à l’opéra, on répète souvent les choses plusieurs fois, et la musique dilue la parole. Avec ce dédoublement parlé-chanté, et le petit groupe de musicien·nes en scène plus connecté·es au jeu, on garde l’urgence de la situation, tout en ouvrant comme une seconde dimension lyrique, émotionnelle, derrière les mots ; et dans l’autre sens, le texte parlé perd son aspect quotidien et réaliste, il se rythme et s’amplifie au frottement de la musique. Il y a comme un conflit de temporalités, qui est en même temps très lié au sujet du spectacle ; et c’est presque comme si les personnages de cette histoire devaient se débrouiller avec des sujets trop grands pour eux, accepter le miracle, remettre en question les fondements de leur existence. Le petit lutte avec le grand, le réel avec le transcendant : vais-je m’abandonner et finir par croire ?
J’ai été subjuguée par l’énormité de ce défi pour des musicien·nes-comédien·nes d’ordinaire si enclin·es à renouveler, questionner, renverser, mélanger, de se retrouver ici face à ce mastodonte de l’opéra, avec tous ses codes, ses attendus et ses spécialistes pointilleux. Qu’à cela ne tienne : Les Incrédules est un spectacle généreux, ambitieux, qui s’aventure dans des registres musicaux et stylistiques assez différents, et assume le fait de raconter une grande et belle histoire.

Une histoire d’opéra ?
C’est une question que je me suis souvent posée : quelles histoires seraient aujourd’hui dignes d’un opéra, dignes de ce gigantisme ? Comment écrire un vrai beau livret contemporain, un conte de notre temps ? La forme de l’opéra me semble toujours appeler un « grand » sujet, quelque chose de structurant, de mythique, de symbolique. Il me semble y avoir comme un décalage entre l’ampleur de l’élément lyrique et orchestral et certains sujets prosaïques, l’effet peut même parfois être comique… Rien de tout cela ici. Le livret imaginé par Samuel Achache et Sarah le Picard, en collaboration avec certain·es artistes de la troupe, est absolument poétique. Il agite les sujets les plus profonds qui soient, sans pour autant verser dans un argument mythologique, ou féérique, ou en empruntant des figures connues d’un passé littéraire : c’est un opéra d’aujourd’hui, mais rempli de l’effroi et de la fascination des mystères du monde, un opéra qui parle de miracles, de vie et de mort, des couloirs du temps.
Est-ce que tout le monde vit ce genre de choses mais personne n’en parle ?
Il commence avec un coup de téléphone : on apprend à l’héroïne que sa mère est morte, d’une crise cardiaque alors qu’elle nageait à la piscine. Quelques secondes plus tard, la mère entre par la porte de l’appartement. Elle a l’air très en forme, elle est même fort élégante, et beaucoup trop jeune. C’est une impossibilité, une absurdité temporelle et pourtant, c’est le point de départ de cette histoire qui pose des questions profondément émouvantes : « est-ce que tout le monde vit ce genre de choses mais personne n’en parle ? », chantent-disent Sarah le Picard et Jeanne Mendoche. Est-ce que nous n’avons pas tous·tes rêvé de pouvoir régler nos comptes avec nos proches avant qu’ils meurent ? Peut-on refuser de mourir, ou refuser d’être une mère ? Est-il possible de faire connaissance avec sa mère avant qu’elle ne soit une mère, une version d’elle-même qui a déjà dû mourir pour nous faire place, mais qui pourrait revenir au moment de la mort ?

Le hasard et l’accident
Cela fait quelque temps que la troupe de Samuel Achache se frotte à la question du miracle : déjà dans La Symphonie tombée du ciel (lire notre article), il était question de mettre en lien la musique avec des témoignages de « miracles véritables », recueillis en France et en Italie à travers une série d’entretiens et de micros-trottoirs. Ici, c’est au mystère de la mort et de la naissance que s’attaquent Les Incrédules, avec justement toute la foi possible : peut-on rencontrer des versions passées de soi-même, ou, si l’on prête suffisamment l’oreille, assister à sa propre naissance ? Le spectacle m’a complètement transportée en ce qu’il ne verse jamais strictement dans le merveilleux, mais qu’il touche avec une tendresse et un optimisme fous des questions très intimes et fondamentales.
Dès les premières minutes de l’opéra, la présence d’un discours scientifique tente parfois de rationaliser la question du miracle, mais devient très vite un territoire de rêverie supplémentaire : étudier les hasards magiques du vivant, pourquoi les pétales se forment d’une certaine manière, dater un os qui aurait dû se trouver dans l’oreille et qui a fini dans le cœur… Le sensible et le rationnel se mêlent puisqu’au final, entre plonger un os dans une solution chimique pour le dater et écouter ce qui résonne à l’intérieur, il n’y a qu’une différence de méthode, mais non une hiérarchie de sérieux. Tout est valable. Mis en contact avec l’improbable, les personnages scientifiques concluent souvent que « ça arrive, c’est possible ». Oui, parfois les os poussent là où ils ne devraient pas. Tout arrive, l’humain est étonnant. Alors pourquoi pas une morte qui refuse de mourir ?
Peut-être que tout – la vie, l’amour – n’est qu’un accident miraculeux.
La troupe de Samuel Achache réussit là une vraie grande œuvre sensible, qui nous rend plus ouvert·es au possible : le hasard produit des incongruités dans la toile (le tapis !) du monde, et nous en savons encore trop peu pour prétendre tout comprendre. Peut-être que tout – la vie, l’amour – n’est qu’un accident miraculeux. Et sur scène, un instrument étrange semble répondre à ce grand coup de dés : une sorte de grande harpe percussive, avec des marteaux lancés qui viennent frapper des cordes tendues en un mouvement de balancier. Souvent manipulé par le multi-instrumentiste génial Thibault Perriard, qui l’a conçu avec les ateliers de l’opéra de Nancy, le « miraclophone » (car tel est son nom) introduit l’aléatoire sur scène et dialogue avec la musique durant tout l’opéra – tout comme nous, humains incrédules, en dialogue perpétuel avec le hasard et ses miracles.
Les Incrédules
Avec l’Orchestre de l’Opéra national de Nancy-Lorraine,Jeanne Mendoche, Majdouline Zerari, René Ramos Premier, Margot Alexandre, Sarah Le Picard, Marie Lambert, Pierre Fourcade, Antonin-Tri Hoang, Sébastien Innocenti, Thibault Perriard
Direction musicale – Nicolas Chesneau
Livret – Samuel Achache et Sarah Le Picard en collaboration avec Margot Alexandre, Thibault Perriard et Julien Vella
Composition – Florent Hubert et Antonin-Tri Hoang
Orchestration – Pierre-Antoine Badaroux
Mise en scène – Samuel Achache
Assistanat à la mise en scène – Chloé Kobuta
Assistanat à la direction musicale – William Le Sage
Dramaturgie – Julien Vella
Costumes – Pauline Kieffer
Scénographie – Lisa Navarro
Conception du miraclophone – Thibault Perriard
Lumière – César Godefroy
Ingénieur son – Julien Aléonard
Décors – Atelier de décors de l’Opéra national du Rhin
Costumes – Ateliers de l’Opéra national de Nancy-Lorraine
Traduction des surtitres en français et en anglais – Richard Neel
Production – Opéra national de Nancy-Lorraine
Coproduction – Opéra national du Rhin
Vu à l’Opéra Grand Avignon, le 23 juillet 2025, dans le cadre du Festival d’Avignon.
Captation disponible sur arte.tv
Tous nos articles sur le Festival d’Avignon.