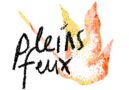Tous les soirs, et ce depuis l’ouverture du festival, se joue au Palais des Papes, le spectacle chorégraphique NÔT (qui signifie « nuit » en cap-verdien). Marlene Monteiro Freitas choisit le conte des Mille et Une Nuits comme “récit-cadre” de son spectacle. La langue arabe est celle invitée cette année 2025, au Festival d’Avignon. Avec un travail de superposition des images, de glissement d’un épisode du conte vers un autre et de ruptures et variations chorégraphiques, NÔT est un spectacle intriguant dont l’étrangeté peut cliver. À ce sujet, lisez l’article de Camille Doucet sur ce même spectacle. Elle y caractérise très bien l’esthétique singulière de Marlene Monteiro Freitas, et saisit les procédés théâtraux à l’œuvre dans les réactions du public. Dans cet article, nous adoptons un angle complémentaire sur le spectacle : NÔT à la Cour d’honneur, c’est chercher un état d’entre-deux à plusieurs échelles.
Le vendredi 11 juillet à 22h, le spectacle NÔT commence à se jouer pour la dernière fois du Festival d’Avignon 2025, sur la scène du Palais des Papes, alors même que tous les spectateurs et spectatrices ne sont pas encore entré·es. Un danseur arrive seul sur scène, habillée d’un t-shirt et d’une jupe blanche. Il danse et se déplace entre les grillages blancs disposés sur scène. Il nous regarde. Une fois qu’il sort, la musique s’arrête et une voix off nous indiquant que le spectacle va pouvoir commencer se fait entendre. Nous savons que le spectacle auquel nous allons assister est un spectacle de danse, mais aussi un spectacle en lien avec le conte des Milles et Une Nuits. Une attente existe alors dans le public : celle de retrouver sur scène les personnages de Shéhérazade et du Roi Shahriar. Autrement dit, nous nous attendons à une adaptation contemporaine et dansée du conte des Mille et Une Nuits.

“Où sont les Mille et Une Nuits ?”
Le premier danseur entre à jardin et s’avance en avant-scène devant un micro sur pied. Il se met à grimacer comme s’il parlait, ce qui suscite des rires dans la salle. Puis, il va s’asseoir au dessus d’une bassine à côté de laquelle se trouve un micro, et sort une grande feuille de papier froissée. À ce moment là, un autre danseur entre, portant un masque de poupée manga jaunâtre et une serviette blanche à la main. Le corps se déplace à la manière d’une poupée robotique. Les deux corps se dansent de manière mécanique. Le danseur installé à jardin émet les sons des déplacements de l’autre danseur, pendant que celui-ci nettoie les éléments du décor en faisant des bruits de respirations très saccadés. Cette scène nous donne l’impression que le danseur assis à jardin est un homme ayant du pouvoir, un pouvoir presque marionnettique sur l’autre danseur (il peut être le Roi Shahrira ?). L’autre danseur joue cette sorte de femme-poupée effrayée qui entre dans l’espace de la scène à cour, où se trouve un lit. Cet espace que nettoie ce personnage peut-être perçu comme une chambre, la chambre de Shéhérazade effrayée de vivre la dernière nuit de sa vie ?
Cette première scène du spectacle semble être en lien avec le conte des Mille et une Nuits à la manière d’un prologue dansé, où l’on peut identifier par analogie les deux personnages principaux du conte. Or, cette idée se retrouve vite estompée par le reste du spectacle. Plus nous avançons dans la chorégraphie, plus les images créées nous renvoie à des éléments tout autres que ceux du conte des Mille et Une Nuits. S’opère un glissement qui déjoue cette attente du public qui perd aussitôt les repères archétypaux qu’il attendait. Le voyage de ce spectacle ne sera pas celui au sein des Mille et Une Nuit, bien qu’il soit cadré par lui, mais autre chose de grinçant et de malaisant. Un glissement des images sur scène s’opère, ainsi qu’un resserrement progressif avec le public.
Il semble que tout part de là : l’étrangeté de cette entre-deux mi-éveillé et mi-rêvé, mi-fictionnel et mi-réel, mi-ancien et mi-actuel
Pendant cette première scène, les autres danseurs et danseuses entrent dans des robes noires et blanches et s’installent à cour à la manière d’un conclave. Ils et elles sont plus en fond de scène. Leur présence en second plan créer une superposition intéressante : cette image nous rappelle le lieu dans lequel nous nous trouvons et nous montre que les corps sur scène ne sont pas pensés uniquement comme des personnages de conte, mais aussi des personnages de la réalité. La superposition de l’image de la première scène qui pourrait être caractérisée comme une image du conte, avec celle des sortes d’évêques qui chantonnent et gesticulent en chœur de manière rituelle, est un exemple pour comprendre sur quelles modalités dramaturgiques semble se modeler la pièce. Marlene Monteiro Freitas le dit elle-même, cette pièce est construite sur un principe analogique où les choses s’opposent et se superposent. Ici, le conte des Mille et Une Nuits est esquissée par la première image et se dissous dans les superpositions des images chorégraphiées. L’entrée des autres danseurs et danseuses évêques dans la scène rituelle constitue une image méta-théâtrale qui rappelle au public où il se trouve historiquement et géographiquement : dans la Cour d’honneur du palais des Papes au Festival d’Avignon en 2025. De cette manière, la chorégraphe se place au carrefour de deux images, de deux oppositions. Il semble que tout part de là : l’étrangeté de cette entre-deux mi-éveillé et mi-rêvé, mi-fictionnel et mi-réel, mi-ancien et mi-actuel.

NÔT, une « série-conte » pour dire notre histoire actuelle
Ma porte d’entrée a été ce récit-cadre, le conte initial qui déclenche une série de conte “robinet” d’où l’eau ne cesserait de couler
Marlene Monteiro Freitas
Il semble que cette première superposition d’images dont nous parlions est le déclenchement d’une longue série de superpositions et de contes. Marlene Monteiro Freitas créer des scènes dansées qui se succèdent les unes à la suite des autres, où qui se superposent les unes sur les autres. La pièce devient une nuit de plus au sein de laquelle il y a de multiples contes racontés. Pourquoi cette affluence de contes en une seule nuit, plutôt qu’un seul conte pour une nuit ? Que cherche à dire et montrer Marlene Monteiro Freitas au travers de chaque scène et chaque mouvement ? Cette dernière question touche peut-être la difficulté du spectacle, celle de réussir à donner accès au public aux propos sous-jacents de ses contes : au sens de chaque épisode du spectacle. Où est le sens ? Si l’attente de voir les Mille et Une Nuits s’est rapidement estompée, il a fallut du temps pour comprendre les codes de danse qui se déployaient sur scène. Néanmoins, certaines images pouvaient être frappantes de sens. Par exemple, lorsque Mariana Tembe est seule sur le lit à cour, elle s’habille d’une étoffe bleu roi et d’une écharpe rouge sang. Elle se coiffe ensuite d’une mitre (la coiffe que porte les évêques). Elle porte en plus, un masque de poupée manga. L’image produite se situe dans cet entre-deux de l’univers fictionnel, dystopique et dérangeant du spectacle, et de notre présent théâtral réel. Le masque rappelle les corps mécaniques des danseurs, la mitre rappelle la salle dans laquelle nous nous trouvons. Les étoffes nous rappellent un Roi, un personnage de conte. Après avoir porté un temps ces costumes, la danseuse modifie la manière dont elle les porte. Elle fait de son écharpe rouge une sorte de ceinture qui passe au dessus de son épaule et sa taille. Elle prends ensuite sa mitre, la retourne et se la met sur la tête. Je l’observais le faire lorsque l’image est apparut : Christophe Colomb. Cette image m’a fait pensé automatiquement à Christophe Colomb, bien qu’il puisse s’agir de quelqu’un d’autre. Peu importe qu’il s’agisse de la bonne interprétation ou non, l’idée est là. C’est-à-dire, la transformation de l’évêque en soldat, en colon, en homme de guerre. Ainsi, l’image a pris sens dans l’ensemble de la scène.
NÔT peut-être pensé comme un spectacle constitué de trois éléments : la méta-théâtralité de la pièce, le récit-cadre qu’est les Mille et unes Nuits, et les contes de nos actualités. Marlene Monteiro Freitas semble entremêler ces trois éléments dans des esthétiques scéniques et chorégraphiées basées sur l’analogie entre différentes notions et depuis différentes échelles.

Pour raconter et chorégraphier tout cela, Marlene Monteiro Freitas a choisi une esthétique qui se rapproche de la science-fiction et de série dystopique comme Squid game ou encore Black Mirror. Le conte NÔT est formellement plus une série d’épisodes qu’une série de contes, dans laquelle est raconté notre histoire contemporaine depuis l’aliénation par le travail, jusqu’à la dictature, en passant par l’histoire colonial et ses violences. Marle Monteiro Freitas renverse l’esthétique du conte et joue non plus avec le rêve et l’émerveillement, mais avec le rêve et l’effraiement. Bien que les images sont évocatrices, chaque épisode du conte n’est pas assez clair de sens. Nous passons à côté de beaucoup de choses, peut-être trop ? Le moment de basculement dans l’introduction du spectacle, le déclencheur de ce ruissellement d’épisodes dystopiques et étranges n’est pas assez clair pour le public. Ainsi, il semble qu’en perdant le fil du sens, nous restons soit à sa recherche et dans les moments de plaisir d’en saisir quelques uns, soit dans la frustration de ne pas avoir ne serait-ce qu’un peu de ce dont on s’attendait, c’est-à-dire, une adaptation classique et/ou stéréotypée des Mille et Une Nuits. La mise en scène aurait gagné à poser plus clairement les différents fils chorégraphiques conducteurs du sens de NÔT avant de nous faire glisser dans son avalanche d’images. NÔT évite l’outrage au public et se concentre sur la maîtrise et le contrôle des corps, comme en témoigne le grand travail chorégraphique et la qualité des danseurs et danseuses aussi musiciens et musiciennes sur scène.
NÔT
Chorégraphie – Marlene Monteiro Freitas
Avec – Marie Albert, Joaozinho da Costa, Miguel Filipe, Ben Green, Henri « Cookie » Lesguillier, Tomas Moital, Rui Paixao, Mariana Tembe
Assistanat choregraphique – Francisco Rolo
Conseil artistique – Joao Figueira, Martin Valdes-Stauber
Scénographie – Yannick Fouassier, Marlene Monteiro Freitas
Assistante à la scénographie – Emma Ait Kaci
Lumieres et direction technique – Yannick Fouassier
Costumes – Marlene Monteiro Freitas, Marisa Escaleira
Son – Rui Antunes
Présenté dans la Cour d’honneur du Palais des Papes, dans le cadre du Festival d’Avignon, du 5 au 11 juillet.
Prochaines dates
6 au 9 août – International Summer Festival Kampnagel, Hambourg (Allemagne)
14 et 15 août – Berliner Festpiele / Tanz im August, Berlin (Allemagne)
28 et 29 août – La Bâtie, Festival de Genève (Suisse)
11 au 14 septembre – Culturgest, Lisbonne (Portugal)
19 et 20 septembre – Rivoli, Teatro Municipal do Porto (Portugal)
6 au 8 février 2026 – Onassis Stegi, Athènes (Grèce)
20 et 21 février – PACT Zollverein, Essen (Allemagne)
4 et 5 mars – Le Quartz, Scène nationale de Brest
25 au 28 mars – La Villette, Paris
22 et 23 avril – La Comédie de Clermont-Ferrand
29 et 29 avril – MC2: Grenoble
6 et 7 mai – Maison de la Danse, Lyon
14 au 17 mai – Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles (Belgique)