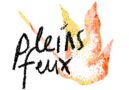Bérangère Vantusso prend la tête du théâtre Olympia – CDN de Tours, et ouvrait mardi dernier la saison avec sa mise en scène de Rhinocéros. Créée à Nancy en janvier, la pièce sert d’introduction pour la metteure en scène auprès du public tourangeau, et place d’emblée la programmation sur un plan politique et poétique.
Ionesco aujourd’hui ?
Si l’on n’a de cesse de remonter les « classiques », et que chaque saison théâtrale voit refleurir Molière ou Shakespeare qui prouvent bien leur résistance au temps et leur indiscutable modernité, certaines pièces plus récentes n’ont pas toujours cette chance. C’est notamment le cas du théâtre de l’absurde des années 1950-60 : pris dans une théâtralité très particulière, ces textes semblent laisser nombre de metteur·es en scène frileux·ses. Pari tenu pour Bérangère Vantusso, mise au défi par Julia Vidit, directrice du Théâtre de la Manufacture à Nancy, de monter un de ces fameux « classiques »… Après une relecture attentive de Marivaux, Brecht, Shakespeare et même Feydeau, le choix de la metteure en scène se porte sur le trop rare Ionesco. « Tiens, on monte encore ça aujourd’hui ? », me demandent des amis du métier lorsque je leur annonce ma visite à Tours. Étrange mauvaise presse pour cet Ionesco qu’on dit suranné, vieillot, trop codifié, « on ne fait plus du théâtre comme ça aujourd’hui »… Bien consciente de ces difficultés, Bérangère Vantusso danse sur un fil délicat qu’elle tient tout du long : assumer un certain aspect artificiel et distancié de la forme dans les codes de jeu et de scénographie qu’elle emprunte, tout en révélant le concret de ce qui se joue dans cette parabole. Qu’est-ce que Ionesco peut nous dire de notre monde actuel ?
C’est une pièce contre les hystéries collectives et les épidémies qui se cachent sous le couvert de la raison et des idées.
L’histoire en est assez simple : le dramaturge nous dépeint un monde bouleversé par des apparitions subites de rhinocéros qui dévalent les rues et défoncent tout sur leur passage. Il y a celleux qui n’y croient pas, celleux qui sont traumatisé·es, mais aussi celleux qui se laissent contaminer… car la « rhinocérite » est comme une maladie, et elle se propage bien rapidement dans cette petite ville où l’on compte bientôt plus de rhinocéros que d’humain·es. En 1958, Ionesco écrit une parabole de la montée du nazisme. Mais dans la préface de son œuvre, écrite en 1964, il ouvre lui-même son propos à une perspective plus large : « Rhinocéros est sans doute une pièce antinazie, mais elle est aussi, surtout, une pièce contre les hystéries collectives et les épidémies qui se cachent sous le couvert de la raison et des idées, mais qui n’en sont pas moins de graves maladies collectives dont les idéologies ne sont que les alibis ».

Repenser l’absurde
On peut dire tout et son contraire, il suffit d’empiler des cubes.
Bérangère Vantusso prend à bras-le-corps la difficulté du « théâtre de l’absurde » : il faut trouver un code pour raconter cette histoire, la défaire de tout réalisme et la porter sur un niveau supérieur, quasiment abstrait. Elle électrise son plateau en travaillant sur des corps marionnettiques, presque chorégraphiés ; la pièce s’ouvre sur des traversées de plateau réglées au millimètre pendant lesquelles les comédien·nes tiennent leurs costumes à bras le corps comme d’étranges poupées de chiffon avant de les enfiler en rythme, sur la création musicale minimale d’Antonin Leymarie. Le plateau est rempli de petits cubes blancs qui figurent à la fois le mur de fond de scène et parsèment le sol. Dans cet espace mathématique qui se fait et se défait, tout prend la froideur et l’absurdité des raisonnements des logiciens : on peut dire tout et son contraire, il suffit d’empiler des cubes, comme dans les syllogismes idiots – tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, Socrate est un chat. L’absurde y est pris de manière littérale, il faut assumer que c’est un théâtre non réaliste, philosophique presque, où l’aspect parfois suranné de la langue participe d’un code de jeu généralisé, comme un objet étrange dont on contemplerait de loin la mécanique parfaite. La brillante adaptation de Nicolas Doutey ne fait que renforcer ce dispositif, avec un travail sur les répétitions, la déréalisation, qui entretient notre impression de nous trouver dans un système bien huilé en train de se détraquer.
Dans ce code-là, les cubes peuvent devenir n’importe quoi : un téléphone, une porte, une sonnette, une chaise, un chat écrasé… C’est comme un jeu dangereux mais aussi une reconfiguration permanente de la réalité. Comment appeler et nommer les choses correctement quand tout est un cube blanc ? Comment appeler encore un chat un chat, ou un cube un cube ? « Tout ça me semble clair, mais ça ne résout pas la question », riposte Béranger aux logiciens ; gare aux apparences, aux faux raisonnements et aux raccourcis. « Est-ce que vous niez toujours l’évidence rhinocérique ? » s’écrie Béranger de plus en plus angoissé. Mais la pensée précise semble impossible quand tout se ressemble.
Comment devient-on rhinocéros ?
Comment avoir raison seul contre toustes ?
Le plus terrifiant, c’est alors de voir se reconfigurer non seulement les cubes qu’on empile et qu’on casse à volonté, mais aussi les humain·es autour de nous. La lecture contemporaine de Ionesco par Vantusso fait ressortir des correspondances très fortes : la peur de la contamination et la tentative de se barricader pour fuir « l’épidémie » – le mot est prononcé, dans la pièce et dans la préface de Ionesco, si violent encore en nous après l’épisode du COVID –, les fake news, le danger de toute idéologie qui prétendrait réordonner le réel à son image. On entend très fort la perversité des discours lorsque les proches de Béranger commencent à changer. C’est notamment le cas de son grand ami Jean, le premier à céder à la rhinocérite, et qui se met à prôner le langage de la vigueur, de l’énergie, de la vitalité. C’est dans la nature, au fond, de redevenir une bête qui fonce, qui casse tout et fait advenir un nouvel ordre des choses…. « Tu n’aimes pas ma respiration ? » demande Jean à Béranger, inquiet d’entendre le râle animal se frayer un chemin dans les poumons de son ami. On croirait presque entendre un discours d’extrême-droite accusant les autres d’intolérance. J’ai toujours aimé les cornes, j’ai comme une envie de défoncer des vitrines et de courir dans les rues ; sois tolérant avec ma violence. Mais il y a aussi les plus pernicieux peut-être, ceux qui se transforment en toute bonne conscience, par lâcheté et par effet de masse, pour « vivre avec son temps », au nom de l’expérience. On n’a jamais essayé… pas vrai ?

Bérangère Vantusso et son équipe réussissent une prouesse, celle d’évoquer cette rhinocérite par des moyens détournés qui nous la rendent plus effrayante encore. Dans les scènes de transformation « en direct », nul artifice : ni maquillage, ni costume, ni effet spécial pour raconter cette intime estrangement de l’autre qui s’éloigne à vue d’œil. Le familier sous nos yeux devient inquiétant, sans autre soutien qu’une intelligence du texte et du corps qui tient sa tension jusqu’au bout. Le rythme ne cède jamais, il se densifie même dans cette machine implacable, il devient plus concret et se resserre comme la fable et le décor se referment sur Béranger. Comment avoir raison seul contre toustes ? « Je te piétinerai », martèle Jean en disparaissant. Mais la pièce nous offre aussi l’ultime résistance de Bérenger, le poing levé dans les ténèbres.
Rhinocéros
Texte – Eugène Ionesco
Adaptation et dramaturgie – Nicolas Doutey
Mise en scène – Bérangère Vantusso
Avec – Boris Alestchenkoff, Simon Angles, Thomas Cordeiro, Hugues de la Salle, Tamara Lipszyc et Maika Radigale
Assistanat à la mise en scène – Pauline Rousseau
Scénographie – Cerise Guyon
Lumières – Anne Vaglio
Musique originale – Antonin Leymarie
Son – Grégoire Leymarie
Costumes – Sara Bartesaghi Gallo
Direction technique et régie générale – Philippe Hariga
Régie – Vincent Petruzellis et Léo Taulelle
Administration et Production – Flavia Amarrurtu, Cie T
A voir jusqu’au 4 octobre au Théâtre Olympia – CDN de Tours
Prochaines dates
5 au 14 décembre au Théâtre Silvia Monfort (Paris)
13 et 14 février 2025 au 140 (Bruxelles)
20 et 21 mars à l’ACB (Bar-le-Duc)
3 avril au Carreau (Forbach)
16 et 17 avril au Théâtre d’Auxerre
24 et 25 avril à la Maison de la Culture d’Amiens
23 mai au Grand R (la Roche-sur-Yon)
Tous nos articles théâtre.