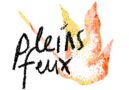Au Théâtre du Jeu de Paume, dans le cadre du Festival international d’art lyrique d’Aix-en-Provence, est donné Songs and Fragments, petit spectacle de théâtre musical. Derrière ce titre laconique, se révèle un diptyque : d’une part, Eights Songs for a Mad King, pour voix d’homme et ensemble, composé par Peter Maxwell Davies sur un livret de Randolph Stow et, d’autre part, les Kafka-Fragmente de György Kurtág, sur des textes de Franz Kafka, pour soprano et violon. L’usage d’une forme simple – le miroir qui sépare et renvoie dos à dos ces deux pièces – permet à son metteur en scène, Barrie Kosky, de nous présenter “deux œuvres très différentes, toutes deux mues par un principe de performance”, propices à la création d’un moment intimiste. Songs and Fragments est un spectacle dont l’exquise petitesse de la forme met en exergue sa grande richesse musicale et performative, grâce à la présence scénique exceptionnelle des interprètes et la justesse de la mise en scène.
Le tout petit fil de quelque chose
Songs and Fragments est l’envers d’un monde de l’énorme, du bruyant, du monumental et de l’épique. A l’inverse du gigantisme qui définit souvent l’opéra, Barrie Kosky fait le choix d’ouvrir le rideau sur “le tout petit fil de quelque chose”, une succession de dialogues et de monologues, comme autant de bribes de l’esprit divisé et déformé d’un homme scindé puis d’une femme perdue. Éclairé et mis en scène par une poursuite, le spectacle est chorégraphié dans le dépouillement et la simplicité qu’appellent les deux œuvres choisies. Tour à tour, la lumière montre, se désintéresse, accompagne, poursuit et menace. Elle entoure le corps de l’interprète, une main, ses jambes, puis seulement son visage comme dans un médaillon, enfin, sa bouche. La lumière désigne la voix, jamais tranquille, comme protagoniste commun.
Personne ne chante plus purement que ceux qui sont dans l’enfer le plus profond ; c’est leur chant que nous prenons pour celui des anges.
– Kafka-Fragmente : Partie III, fragment 24
Expressionnistes par leur traitement des œuvres, Barrie Kosky et ses interprètes ne peuvent ni ne veulent approcher l’illustration. A l’image des deux “personnages”, ils projettent leur subjectivité sur la réalité, la distordant en lui insufflant une plus grande intensité expressive. Songs and Fragments est une errance dans la psyché de deux êtres, “cartes postales de l’âme” au bord de la folie. Et nous, spectateur·rices, sommes invité·es à partager cette pérégrination, au sens physique comme psychique.
Le seuil de la folie est incertain
La lumière s’éteint soudainement, un hurlement bref de vents et de percussions, puis démarre la pulsation, comme le tic-tac de l’horloge, un coucou incessant et rapidement perturbé qui n’indique plus rien que son propre détraquement. Eight Song for a Mad King est un conte inquiétant, celui d’un roi, George III – brillamment incarné par Johannes Martin Kränzle -, progressivement gagné par la démence. Tout à son principe de réduction, Barrie Kosky aborde ce personnage en le dépouillant des attributs liés à son caractère historique, pour nous présenter un “simple” homme dans sa solitude. C’est un roi fou, ou un fou qui se prend pour un roi, mais jamais un personnage de foire. En choisissant une entrée psychologique et non historique pour aborder cette œuvre, Barrie Kosky et les interprètes portent leur attention sur le dérèglement interne du personnage avant toute autre chose.
La figure du fou, moqué et maltraité, dans un état d’isolement total à la fin de l’œuvre, est abordée avec empathie, par le prisme de la déstigmatisation de la maladie mentale.
Composée en 1969, l’œuvre de Peter Maxwell Davis est imprégnée par le contexte de remise en question des pratiques psychiatriques de son époque. La figure du fou, moqué et maltraité, dans un état d’isolement total à la fin de l’œuvre, est ainsi abordée avec empathie, par le prisme de la déstigmatisation de la maladie mentale. Comment, alors, rendre justement la réalité de la folie qui prend progressivement le contrôle sur cet homme sans tomber dans le grotesque, le convenu ? Est-ce que cela passe par un léger travestissement, par la quasi-nudité de l’interprète, par la sensation d’isolement anxiogène dans la boîte noire qu’est devenue la scène ? Ou bien s’agit-il du maquillage de l’œil, de ce sourcil dessiné grossièrement comme une référence à la signature du clown blanc ? En partie, certainement, mais c’est avant tout par la voix que s’exprime le déchaînement intérieur, ou ce qui sort de la voix, “de la musique, mais une musique terrible”. Une impression accentuée, souligne Laurent Feneyrou, par la bizarrerie instrumentale, qui ne soutient que peu la voix et, au contraire et à l’inverse des Kafka-Fragmente, creuse l’écart avec elle.
Il y a un but, mais pas de chemin ; ce que nous appelons un chemin est une hésitation.
Kafka-Fragmente : Partie III, fragment 27
Lieu privilégié de l’expression des sentiments traversés par cet homme, la voix permet à Johannes Martin Kränzle d’aller vers son essence dans un moment de grande intensité et de travailler avec justesse la complexité de ces sentiments. Cette exploration est rendue possible par la nature même de l’oeuvre : passant par cinq octaves différentes et diverses techniques vocales appelées par la convocation de références éclectiques (Haendel, le fox-trot, la musique des années 1920 et 1930…), Peter Maxwell Davis attend à la fois fantaisie et exigence de son interprète. Un défi impossible que relève Johannes Martin Kränzle avec justesse, vagabondant entre ces références tel un Wanderer introspectif.

L’une chante, l’autre pas
Le système de notation utilisé par Kurtág exige une justesse totale de son interprète, devant passer des cris au rire, du chuchotement au gémissement, du bruitisme au bel canto, du chant lyrique au parlé-chanté.
Kaléidoscope en quarante temps, ce sont ensuite les facettes du portrait d’une femme qui se déploient dans les Kafka-Fragmente, deuxième partie de Songs and Fragments. À la manière du travail conjoint de Johannes Martin Kränzle et de Barrie Kosky, cherchant à dépasser le caractère historique du personnage de George III pour atteindre ce qui serait l’essence d’un homme au seuil de la folie, ce dernier aborde ensuite, aux côtés de la soprano Anna Prohaska, cette femme comme une idée. Elle est moins un personnage qu’une psyché, explorée et construite grâce aux possibilités de sa voix. Passant du grave au léger, du dansant au figé, sans jamais perdre la distance sarcastique nécessaire pour aborder certains des fragments, Anna Prohaska dit considérer cette œuvre comme un Winterreise au féminin, rapprochant aussi les Kafka-Fragmente de l’Erwartung de Schönberg. Comme dans Eight Songs, personnages et interprètes vont jusqu’à l’épuisement, explorant les régions limites de l’expérience humaine. Le système de notation traditionnel utilisé par Kurtág exige une justesse totale de son interprète pourtant éprouvée par l’ambitus immense de l’œuvre, devant passer des cris au rire, du chuchotement au gémissement, du bruitisme au bel canto, du chant lyrique au parlé-chanté. Une démarche qui s’explique par sa quête : rendre le chant des textes de Kafka, en donnant à chaque mot son espace musical.
La voix, pourtant, n’est pas seule à parler. Le duo formé sur scène par Anna Prohaska et la violoniste Patricia Kopatchinskaja, doit bientôt ne faire plus qu’un. Leur entente est palpable, Kopatchinskaja adaptant son discours musical à la voix, lui donnant de l’élan, une indication, une direction. Les deux échangent constamment, avec fluidité et complicité. Ainsi, l’instrument lui aussi est éprouvé par les stridences, les grincements, les grattements, les scordatura. Alors que les dialogues d’Eight Songs s’apparentaient bien plus à des monologues, tournés vers des objets, animaux, ou l’homme lui-même, ce qui se joue dans les Kafka-Fragmente est tout à fait différent : il s’agit de “la rencontre entre deux personnages, deux instruments mélodiques”. Le violon, cette fois, ne cherche pas à creuser l’écart avec la voix ; au contraire, il la soutient et s’en rapproche. Les deux interprètes, violoniste et soprano, doivent progressivement devenir interchangeables, non seulement par leur apparence qui en fait des quasi-jumelles, mais aussi parce que la voix se fait grinçante, comme l’appui de l’archet sur les cordes, tandis que la ligne musicale du violon se rapproche de celle des cordes vocales. L’une chante, l’autre pas, l’une joue, l’autre pas, mais laquelle est laquelle ?
Le clair de lune nous éblouissait.
– Kafka-Fragmente : Partie IV, fragment 40
Les oiseaux criaient d’arbre en arbre.
Dans les champs, cela sifflait.
Nous rampions à travers la poussière, un couple de serpents.
Les chemins tortueux que nous avons empruntés tout au long des errances de ces deux êtres s’achèvent en une mélodie serpentine. Au fragment 40, surgit brusquement une structure mélodique, inattendue, et les deux langues sifflent de concert. Anna Prohaska et Patricia Kopatchinskaja, enlacées, la tête de l’une contre celle de l’autre, sont cernées par la poursuite qui se resserre progressivement sur elles, pour ne nous montrer plus que leurs visages. Voici comment s’achève le voyage : il semblerait que, dans le rapprochement avec l’autre, quelque chose ait été trouvé.
Songs and Fragments
Mise en scène – Barrie Kosky
Espace et lumière – Urs Schönebaum
Assistante à la mise en scène – Dagmar Pischel
Eight songs for a mad king (Peter Maxwell Davies / Randolph Stow)
Direction musicale – Pierre Bleuse
Assistant à la direction musicale – Levi Hammer
Un homme – Johannes Martin Kränzle
Orchestre – Ensemble Intercontemporain
Kafka-Fragmente (György Kurtág / Franz Kafka)
Une femme – Anna Prohaska
Une violoniste – Patricia Kopatchinskaja
6 – 14 juillet, Festival d’Aix-en-Provence