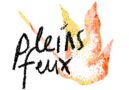Au Théâtre du Train Bleu, la compagnie Akté propose avec La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal une reconstitution mot pour mot d’un débat radiophonique dans l’émission d’Alain Finkielkraut « Répliques », entre l’essayiste Jean-Michel Delacomptée et la philosophe Camille Froidevaux-Metterie sur les questions de sexisme et de féminisme. Une réussite théâtrale fascinante dans sa mise au jour de la conflictualité des discours et jouissive dans son incarnation scénique.
Nous sommes à la Maison de la Radio, le 4 décembre 2021. Dans les studios de France Culture, Alain Finkielkraut accueille dans le cadre de son émission « Répliques » deux figures aux antipodes de la pensée : la philosophe féministe Camille Froidevaux-Metterie et l’essayiste réactionnaire Jean-Michel Delacomptée. Le temps d’une heure d’émission se déploie alors une intense joute idéologique et verbale sur le féminisme, le mouvement metoo, et plus globalement les rapports contemporains entre les hommes et les femmes. Au Théâtre du Train bleu, la compagnie Akté et la metteuse en scène Anne-Sophie Pauchet proposent avec La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal une reconstitution parfaitement fidèle, au mot près, de cette émission. On pourra légitimement se demander en amont si une telle transposition à la scène, à l’identique, d’un programme que l’on peut pourtant toujours écouter en podcast, revêt un quelconque intérêt. À cette interrogation, le spectacle de la compagnie Akté apporte une réponse implacable : un oui fort et flamboyant.
Affrontement et corporalité
Le spectacle rend incroyablement corporelle et concrète cette opposition philosophique qui n’a rien d’abstrait, puisqu’elle est éminemment politique.
Tout d’abord, par l’opération de monstration physique des corps derrière les voix qui, par définition, sont invisibles dans le cadre radiophonique, et de la scénographie de la controverse telle qu’elle est organisée par la disposition du studio, La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal met à jour la structure matérielle de l’affrontement. En donnant en effet non seulement à entendre, mais aussi à voir, les postures, les réactions (yeux qu’on écarquille ou qu’on lève au ciel, haussements d’épaule, hochements de têtes), les gestes, bref toute la panoplie de la communication non-verbale, le spectacle rend incroyablement corporelle et concrète cette opposition philosophique qui n’a rien d’abstrait, puisqu’elle est éminemment politique. Quand Camille Froidevaux-Metterie et Jean-Michel Delacomptée se font face de chaque côté de la table (même si le second a parfois bien du mal à soutenir le regard de la première et lui tourne ostensiblement le dos), Alain Finkielkraut se situe au centre dans une position qu’il aimerait être celle du modérateur neutre, mais qui se révèle bien vite pencher plus d’un côté que de l’autre.
Et si l’aspect corporel est si important, c’est aussi que la question du corps est au centre du débat. En philosophe phénoménologue, Camille Froidevaux-Metterie, autrice d’Un corps à soi, part en effet de l’expérience corporelle féminine pour fonder sa pensée de l’émancipation. Dans sa pensée inspirée de Simone de Beauvoir et Iris Marion Young, c’est en se ressaisissant de leur propre dimension incarnée, malheureusement marquée par les violences et la domination, que les femmes pourront trouver les fondements de leur liberté. Face à ce projet de transformation de la société toute entière par le corps, les deux mâles tentent de s’accrocher à des arguments qui ne font pas le poids, du « Not all men » à la mixité heureuse, en passant par la complexité du désir.

Deux contre une ne font pas le poids
Il est fascinant d’observer comment le ballet codifié du débat radiophonique, avec son cortège de politesses recouvre sous ce vernis une conflictualité extrême et âpre, celle de deux visions du monde radicalement incompatibles.
Dans ce contexte, on constate de manière éclatante ce que l’engagement de chaque adversaire dans ses interventions révèle in fine de leur crédibilité : le discours de Camille Froidevaux-Metterie est incroyablement articulé, étayé, argumenté, et précis, quand celui de Jean-Michel Delacomptée est bien plus souvent brouillon, très subjectif, et fallacieux. Ainsi, à l’énoncé martelé et statistique des violences patriarcales dont les femmes sont les victimes depuis des siècles, il répond « mais où est le sentiment ? », oppose des faits particuliers aux énoncés sociologiques, change de sujet (et les jeunes hommes dans tout ça ?) et se drape d’un « je ne comprends pas ce que vous dites » quand l’idée exprimée lui est trop intolérable. Chaque interruption d’Alain Finkielkraut, absurde ou lyrique, montre à quel point il semble quant à lui perdu, aucunement conscient qu’il se situe bel et bien dans le socle patriarcal qu’il est précisément question de déconstruire. À ses questions pseudo-polémiques (et la souffrances des laids qui se font repousser par les femmes en boîte de nuit ? et le tribunal médiatique qui s’acharne sur Nicolas Hulot ?), Camille Froidevaux-Metterie fait elle tout l’étalage de sa maîtrise philosophique et de sa classe discursive, ne se démontant jamais, répondant patiemment et avec précision à chaque question absurde, posant les définitions justes, rappelant sans broncher les victimes réelles du systèmes patriarcal et la portée révolutionnaire du féminisme. Interprétée par Anne-Sophie Pauchet elle-même, comme elle est formidable dans sa droiture, brillante et imperturbable !
Malgré le déséquilibre de la parole – deux hommes contre une femme, reproduction miniature du déséquilibre systémique – elle n’est jamais irrespectueuse de ses interlocuteurs, quand bien même ceux-ci s’excitent, s’agitent et soufflent comme des adolescents frustrés et outrés. Il est d’ailleurs fascinant d’observer comment le ballet codifié du débat radiophonique, avec son cortège de politesses (« votre livre est très intéressant au demeurant, là n’est pas la question » ; « ce n’est pas vous personnellement »), recouvre sous ce vernis une conflictualité extrême et âpre, celle de deux visions du monde radicalement incompatibles.
Enfin, toute la qualité de La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal est décuplée par la performance de ses trois acteur·ices. On a mentionné Anne-Sophie Pauchet, remarquable de sérieux. En face d’elle, la pipe au bec, Juliette Lamour interprète un Jean-Michel Delacomptée truculent et hypocrite (belle ironie que celle de faire jouer l’essayiste sexiste par une femme). Julien Flament, quant à lui, excelle dans l’incarnation de l’insupportable Alain Finkielkraut, dont il capture délicieusement bien le débit et les inflexions – ah, sa manière nasale et légèrement condescendante de prononcer « les femmes »…

Véritable banger théâtral, jouissif et passionnant, le projet de transposition est plus qu’abouti. L’ensemble du spectacle à la fois révèle et renverse les dynamiques de domination à l’œuvre dans la société : deux hommes au discours rétrograde, en position de pouvoir médiatique, rendus absolument et totalement ridicules par la pensée articulée d’une femme férocement intelligente. Et il est difficile de ne pas voir en Jean-Michel Delacomptée et en Alain Finkielkraut deux crapaud buffles boursouflés en fin de vie, terrassés par le souffle de la révolution féministe en cours. Et ça fait du bien.
La lente et difficile agonie du crapaud buffle sur le socle patriarcal
Texte d’après l’émission radiophonique Répliques de France Culture du 4 décembre 2021
Mise en scène – Anne-Sophie Pauchet
Distribution – Juliette Lamour, Julien Flament et Anne-Sophie Pauchet
Création sonore – Juliette Richards
Régie générale – Benjamin Lebrun
Collaboration artistique – Arnaud Troalic
Visuel – David Cauquil
Au Théâtre du Train Bleu, du 5 au 24 juillet à 20h40
Prochaines dates
25 septembre – L’Étincelle | Rouen
5 et 6 mars 2026 -Théâtre Roger Ferdinand (Auditorium La Source), St-Lô
7 mars 2026 – DSN Dieppe – Scène Nationale
Tous nos articles sur le Festival d’Avignon