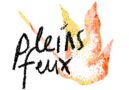Des plateaux alpins aux plateaux parisiens. Performeuse suisse habitée d’une fougue captivante et d’une soif de révolte, Pamina de Coulon cultive depuis de nombreuses années dans sa saga FIRE OF EMOTIONS l’art de l’essai parlé – des formes de seule-en-scène structurées par le flux d’une parole incarnée et nourries d’une infinité de lectures. Dans une perspective féministe, écologiste et décoloniale, passionnante et réjouissante à la fois, Pamina de Coulon y déconstruit nos représentations modernes occidentales et s’attaque par le langage au démantèlement des structures de domination.
Le Théâtre Silvia-Monfort présente ce novembre les deux volets les plus récents de cette recherche en action : NIAGARA 3000, flamboyante diatribe sur l’énergie (lire notre critique), et MALEDIZIONE, nouvelle création qui, à partir de la question du contrôle du corps des femmes, interroge les façons dont on raconte l’histoire.
Pleins Feux a rencontré en mars dernier, puis à nouveau ce mois-ci, cette artiste unique en son genre, pour une conversation dense où elle raconte sa démarche. Pouvoir des mots, déhiérarchisation des savoirs, pensée autochtone, lutte militante, mais aussi glaciers qui parlent, papes maudits, sources et larmes : autant de sujets qui s’entrecroisent et nous invitent à embrasser sans appréhension la complexité du monde.
Yannaï Plettener : Comment conçois-tu un spectacle ? Comment émerge une idée, et quel est le chemin de l’idée jusqu’à la forme finale ?
Pamina de Coulon : NIAGARA 3000 était le quatrième volet de ma saga « FIRE OF EMOTIONS », et MALEDIZIONE en est le cinquième. Ce sont donc des épisodes (même s’il n’y a pas besoin de les voir à la suite pour les comprendre), et beaucoup d’éléments passent d’un épisode à un autre.
Un spectacle ne vient donc jamais de nulle part. Dans chaque spectacle, il reste toujours des choses : des aspects que je n’ai pas pu creuser ou de petits détails qui finissent par prendre plus de place que prévu dans mes réflexions. Des fulgurances me donnent une première direction, que je développe ensuite dans un processus souvent long, trois ans en moyenne. Au cours de ce travail, des thèmes émergent, ou des mots, des concepts… Ce sont eux qui constituent la structure du spectacle. Mais généralement, dans les six derniers mois, il y a quatre ou cinq grands renversements majeurs : des détails deviennent très importants, ou au contraire des éléments structurels disparaissent quasiment.
Y.P. : Dans ta pratique, le travail au plateau est-il concomitant de la recherche et des lectures ?
P.d.C : Non, je travaille très peu au plateau. Pendant ces trois années, je lis et je prends des notes, principalement à la table et dans des canapés. Ensuite, il y a généralement environ deux semaines de travail au plateau, en tout et pour tout. C’est le texte qui impose le plateau, et qui joue avec les scénographies que j’invente. Dans les derniers jours avant les premières, il y a un énorme travail d’édition. Je présente à mes collaboratrices, Alice Dussart et Sylvia Courty, avec lesquelles je travaille respectivement depuis 10 ans et 15 ans, des premières versions qui durent trois heures et demie. Au cours de ces versions, je travaille mes placements de manière intuitive.
Y.P. : Dans le cas de NIAGARA 3000, quelle était l’idée de départ, la fulgurance qui a donné la première direction ?
P.d.C. : C’étaient les larmes. En parlant avec une amie à propos d’une œuvre de l’artiste suisse Sylvie Fleury, un énorme néon rose qui écrivait le mot miracle, nous nous sommes amusées à faire un anagramme : les lettres de « miracle » peuvent écrire « lacrime » ou « lacrimae » (larmes, en italien et en latin). Je me suis alors dit : les larmes, quelle force hydraulique ! Comme je voulais parler d’énergie, ce thème s’est imposé. Au final, c’est toujours ça, bien que je ne le mentionne presque jamais dans le spectacle. Dans tous les éléments de communication et les dossiers artistiques, les larmes ont une place très importante, alors qu’au final, ce n’est pas le véritable sujet du spectacle. Mais c’est de loin celle de mes pièces qui fait le plus pleurer.
Y.P. : Et quel était le point de départ de MALEDIZIONE, ta nouvelle création ?
Une question est donc devenue un fil rouge de la pièce : qui raconte quelle histoire, et à qui cela profite-t-il qu’elle soit racontée de cette manière-là ?
P.d.C. : C’est venu d’une malédiction que j’ai proférée contre le pape Boniface VIII dans le cadre d’une petite performance. J’ai pris la mesure de ce que cela voulait dire de maudire quelqu’un. En le disant, je le pensais très fort ! Ce « maudit pape » est notamment celui qui a édicté les règles strictes de la côture des moniales dans les couvents à la fin du XIIIe siècle, en 1298. Les nonnes devaient être invisibles, enfermées, sans aucun lien avec le reste du monde. Cela m’a rempli d’effroi et de colère, et m’a donné un déclic sur la question du contrôle du corps des femmes. Jusqu’où cela remonte, d’où ça vient, et qui écrit cette histoire ?
Je me suis replongée dans ma période historique préférée, le Moyen-Âge, dans ce que j’en savais et ce que j’aimais. Pour découvrir au final que tout ce qu’on nous apprend à l’école est faux. Que les vieux clichés que nous en avons nous parlent en réalité plus d’aujourd’hui que du Moyen-Âge. Une question est donc devenue un fil rouge de la pièce : qui raconte quelle histoire, et à qui cela profite-t-il qu’elle soit racontée de cette manière-là ?
Y.P. : De quoi ce retour au Moyen-Âge a-t-il été source, dans l’écriture du spectacle ?
P.d.C. : Finalement, comme d’habitude, il en reste moins dans la forme finale qu’il n’y en avait au cours de l’écriture. Je réhabilite quelques clichés, et cela permet de m’interroger sur ce qu’on nous raconte, et comment et pourquoi on y adhère. Cela devient l’exemple de l’histoire majoritaire écrasante, qui s’impose tant qu’on ne la questionne pas, et qu’on utilise comme base pour construire le présent, mais qu’heureusement beaucoup de personnes remettent en question. J’essaie de mettre en valeur ces efforts de mise en avant d’histoires minoritaires, invisibilisées, qu’on peut trouver quand on les cherche. Et si on ne les trouve pas, ce n’est pas grave non plus : tant mieux pour ces personnes tombées dans l’oubli qui ne seront pas instrumentalisées.
Tout cela s’articule toujours dans une perspective de science historique féministe, de recherche sur l’histoire du patriarcat. J’ai lu un des rares ouvrages qui essaie de retracer d’où vient le patriarcat – The Patriachs. The Origins of Inequality, d’Angela Saini. Cette lecture fait des ricochets dans la pièce, sur comment ce genre de domination se met en place, et comment on en parle. C’est d’autant plus actuel vu le moment dans lequel on vit, de retour de la « patrie » et de montée des nationalismes extrêmes, qui participent du patriarcat.

Y.P. : Quel lien fais-tu, dans ta pratique, entre la scène et l’engagement militant ?
P.d.C. : C’est une question qu’on me pose souvent. Qu’est-ce qu’un spectacle « engagé » ? Ce qui m’apparaît, c’est que je fais un spectacle partisan. J’exprime clairement des opinions sur des sujets, sans équivoque.
Si je parle de la lutte dans tous mes spectacles, c’est parce que j’ai une vie militante, ou plutôt ma vie est fondamentalement militante. Comme je m’appuie sur mes expériences pour articuler les grands concepts, il était naturel d’évoquer aussi celles-là. Mais effectivement, il faut les vivre pour en parler.
J’essaie de proposer des portes d’entrée dans les concepts théoriques dont je parle. J’explique comment j’y suis entrée personnellement, comment cela m’a touchée, ou affectée, ou aidée à comprendre autre chose. De la même manière, je propose la vie militante comme quelque chose d’accessible, qui existe, et qui, dans mon cas, fait du sens, crée une articulation dans laquelle je me sens à l’aise.
C’est là aussi qu’il y a un enjeu auquel je reste vigilante. Proposer clairement mon avis sur des choses, mais expliquer d’où il vient et comment il s’est construit, de manière à lui donner plus de consistance. Cette consistance-là permet de l’entendre d’une autre manière, ou de comprendre comment il peut être possible de penser comme ça. Selon moi, c’est une étape qui manque dans d’autres formes de partage de contenu. On n’a plus toujours la place de faire l’effort de dire pourquoi et comment quelque chose nous touche.
Y.P. : Incarner les expériences et les concepts, ce serait l’apport du théâtre aux luttes militantes ?
P.d.C. : Mon public cible, ce ne sont pas forcément des gens déjà convaincus par ce que je dis. Même si cela peut faire du bien, à moi comme à elleux, dans les cas où ça arrive. J’ai l’impression que ce que je fais peut parfois contribuer à une forme de radicalisation, ou à affermir certaines positions. En fonction des spectateur·ices, il y a des positionnements divers de désespoir, de privilèges, de statu quo. De temps en temps, un tel flot d’arguments peut aider à retourner à l’action militante, ou à comprendre les personnes qui militent. En quelque sorte, je fais un peu relais. Je donne des poignées pour se saisir des choses. Pour mettre des petites bûches dans les petits feux.
Y.P. : En quoi consiste la déhiérarchisation des savoirs, que tu revendiques dans ta démarche ?
La force de la déhiérarchisation des savoirs réside donc dans le fait de s’autoriser à reconnaître de très diverses formes de savoir, ressentis comme équivalemment pertinentes, tout en gardant une perspective critique.
P.d.C. : Il s’agit de ne pas faire plus confiance à la recherche scientifique ou à un essai théorique avec une longue bibliographie, qu’à d’autres formes de savoirs. Pouvoir horizontaliser les connaissances. Ainsi, mettre au même niveau ce que ma voisine peut m’apprendre sur la pousse des salades et un autre type de connaissances permet de faire des liens entre les deux.
C’est un ancien concept de mon travail, que je mobilise moins aujourd’hui. Il faut faire attention à ne pas tomber dans un certain confusionnisme qui reviendrait à dire que, de toutes façons, tout se vaut.
En tout cas, c’est une forme d’éthique de sélection des sources. Je fais attention à qui parle et dans quel contexte. Mes sources sont toujours situées. Je considère qu’il n’y a pas de sources qui seraient meilleures que d’autres sous prétexte qu’on aurait l’habitude de les considérer comme telles, ou qu’elles seraient des formes établies de connaissance qui viendraient des universités dominantes. Comme une vision qui dirait par exemple que le savoir sur le soin est exclusivement détenu par les médecins qui ont fait de grandes études, et que toutes les formes traditionnelles de savoir ne seraient que des « remèdes de grand-mère ».
La force de la déhiérarchisation des savoirs réside donc dans le fait de s’autoriser à reconnaître de très diverses formes de savoir, ressentis comme équivalemment pertinentes, tout en gardant une perspective critique.
Y.P. : Cela inclut-il les écrits d’auteur·ices décoloniales et autochtones, de minorités opprimées, de femmes, de personnes queers, que tu mobilises tant dans le spectacle ?
P.d.C. : J’ai une frénésie de lecture. J’ai une trentaine de livres à lire d’ici la création de mon prochain spectacle, et j’aimerais bien savoir à quel moment j’aurai le temps de tous les lire ! Et ça ne s’arrête pas, chaque livre en appelle d’autres… J’adore lire des bibliographies ! Ça été un apprentissage et une révélation de découvrir beaucoup de penseur·euses autochtones, surtout du nord du continent qu’on appelle américain, comme par exemple Jen Rose Smith, la géographe eyak à qui je dois le concept de « normativité tempérée », dont je parle dans NIAGARA 3000, et bien plus (voir petite bibliographie dans l’encadré de fin d’article).
Des auteur·ices comme Max Liboiron dans son ouvrage Pollution is Colonialism, ou Eve Tuck et K. Wayne-Yang dans La décolonisation n’est pas une métaphore, mettent aussi en garde : il y a une politique de la citation. Il faut être vigilant·e à l’extractivisme dans la lecture et dans la citation. J’essaie donc de me familiariser plus avec l’intégralité du travail de quelqu’un·e, plutôt que de n’en extraire qu’une phrase. C’est une manière différente de travailler, qui demande plus de temps et d’engagement vis-à-vis des auteur·ices que je cite. Mais cela permet aussi d’aller plus en profondeur, et de se laisser influencer et dévier par la pensée. C’est une nouvelle relation aux sources qui je trouve rassurante et chaleureuse, une relation vivante, faite d’obligations et d’amitié.
J’essaie de me familiariser avec l’intégralité du travail de quelqu’un·e, plutôt que de n’en extraire qu’une phrase. C’est une nouvelle relation aux sources qui je trouve rassurante et chaleureuse, une relation vivante, faite d’obligations et d’amitié.
Pour PALM PARK RUINS, mon spectacle précédent, j’avais décidé de ne rien lire qui soit écrit par un homme cisgenre, et finalement j’en cite un officiellement, parce que j’avais été touchée par quelque chose. Mais du coup, pendant trois ans, j’ai cherché des livres sur des sujets précis, et à chaque fois j’ai écarté les auteurs principaux qui étaient mis en avant, car c’étaient toujours des mecs cis blancs. J’ai écrit tout ce spectacle qui parle de la pollution des sols en trouvant finalement assez facilement d’autres sources, mais il fallait quand même à chaque fois faire un petit effort pour ne pas prendre la première source mise en avant. Ça m’a permis d’ancrer ces réflexes de recherche plus profondément. Par la suite, j’ai intégré à nouveau des hommes cis : ils ont aussi le droit d’exister, et bienvenue à eux. Mais je l’ai fait avec une attention que je n’avais pas avant. Ce ne sont pas non plus des connaissances ou des propos que je disqualifie complètement, je ne les mets juste pas au sommet de la pile !
Y.P. : Et la parole littéraire, poétique ?
P.d.C. : Oui. Je considère qu’une phrase de poésie peut avoir autant de répercussions que l’explication scientifique d’un phénomène physique. Dans ce grand fleuve de parole qui convoque de nombreuses émotions face à des réalités variées, il y a un endroit où horizontaliser les sources et les formes de connaissance permet de passer plus facilement de l’une à l’autre.
Y.P. : Il y a également une attention toute particulière portée à la force du langage et au choix précis des mots. Par exemple, le fait d’appeler les bouleversements climatiques plutôt « Terre morte / Eau morte », ou de se donner un nom comme « le club des rustiques ». Comment te rapportes-tu à ça dans ton travail ?

P.d.C. : C’est vraiment capital. C’est d’ailleurs le projet de mon prochain spectacle, qui portera sur la malédiction. La malédiction, c’est proférer des mots qui auront une répercussion pluri-générationnelle. On sous-entend donc du pouvoir dans ces mots.
Je m’attache à essayer autant que possible d’être nuancée et précise. C’est délicat ici aussi de ne pas mobiliser une forme inconsciente de classisme qui consisterait à dire qu’il faut faire attention à bien parler. Il ne s’agit pas tant de dire qu’il est important d’avoir un vocabulaire riche et diversifié, que d’être bien certain·e de comment on utilise les mots, et ce qu’ils veulent dire pour nous. Dernièrement, j’ai lu et entendu de nombreuses personnes exprimer une crainte : beaucoup de mots seraient récupérés et retournés, détournés de leur sens. On ne sait plus quoi faire des mots. Pour moi, l’une des solutions reste de les situer : expliciter comment on emploie les mots avant de les utiliser. Pour réduire le doute sur ce qu’on veut dire précisément.
Y.P. : Dans NIAGARA 3000, tu déploies beaucoup les imaginaires en lien avec le minéral, la montagne, l’eau, les glaciers – tous des éléments non-humains. Tu dis à un moment : « Les glaciers ont commencé à parler notre langage ».
P.d.C. : J’ai une affinité pour les cailloux. C’est une particularité de ma personnalité, et qui vient effectivement aussi du fait d’avoir grandi proche des montagnes, les Alpes suisses. Ça vient de ma famille. J’ai des ancêtres qui étaient marchands de granit et avaient une carrière. Par ailleurs, fabriquer des cailloux dans mon corps est une partie de ma maladie. Chronologiquement, tout ça est très mélangé. J’ai toujours été touchée par les pierres.
Dans mon spectacle The Abyss, où je parlais aussi beaucoup de cailloux, je tords un peu la pensée du philosophe Whitehead, qui parle de panexpérimentalisme – au sens où tout a une expérience. Je suis sensible à l’expérience qu’ont les pierres du reste du monde, et par conséquent à la vie qu’elles ont. Au fait que, pour la plupart, elles étaient avant dans de plus grands amas, de plus grandes formations, et qu’elles ont été cassées par l’eau, la glace, l’érosion, les végétaux… Ce sont des frictions de monde qui me parlent d’une animation et d’une vie, plutôt que d’une inanimation. C’est un cadeau que j’ai reçu des cailloux.
Le peu de langage glacier que je parle, c’est quand je regarde le paysage, et que je vois où il y avait des glaciers auparavant qui n’y sont plus maintenant.
Y.P. : Tu parles d’animisme méthodologique…
P.d.C. : J’ai trouvée l’expression dans un entretien de Vinciane Despret. Je suis animiste sans le vouloir : pour moi, toute chose a une expérience, quasiment une conscience. C’est quelque chose qu’ont beaucoup les enfants – puis on le perd en grandissant. Mais, pour ma part, je n’ai jamais vraiment perdu ça. Parler d’animisme méthodologique me permet de rationaliser un peu l’animisme : c’est une méthode d’appréhension du monde. Je choisis de dire que tout a une âme : qu’est-ce que penser cela modifie du monde autour de moi, et de mon rapport à celui-ci ?
Y.P. : Dans la description du projet FIRE OF EMOTIONS, tu parles d’« ode à la complexité », de strates. Peux-tu développer en quoi cet ensemble de pièces constitue une ode à la complexité ?
Chanter les louanges de la complexité, c’est refuser de réduire pour réduire, juste pour faire croire que cela rend les choses plus simples.
C’est en réaction à un discours qu’on nous rabâche, selon lequel les choses seraient trop compliquées à comprendre sans la bonne formation ou le bon accès. Que la complexité serait réservée à quelques rares personnes, et que tout le reste est censé être simple.
Je mets moins cela en avant maintenant dans mon discours, mais quand j’ai commencé la saga, cela me frappait. Ce qui est intéressant dans cette formulation ce n’est pas seulement la complexité, mais aussi l’ode : une forme de louange épique et verbale, un grand poème en hommage à quelque chose. Chanter les louanges de la complexité, c’est refuser de réduire pour réduire, juste pour faire croire que cela rend les choses plus simples.
Je trouve qu’il y a du simple aussi dans le complexe. La complexification comprise comme le mélange des disciplines et des sources, ajoute certes de la complexité, mais chez moi, elle apaise l’angoisse du monde. Avoir à la fois la force et le privilège de me traîner dans la complexité, c’est assez salutaire en ce qui me concerne. Cela fait partie de ce projet : en une heure, parler à la fois de colonisation, et de maladie chronique, et de transformation de la société, et de nucléaire, et de langage, et du fait qu’il y a de moins en moins de châtaignes en Suisse italienne… Tout ça en un temps si court, c’est comme un voyage qui permet de raffermir des idées, ou de ressentir plein d’émotions différentes.
Y.P. : Et sur scène, tu parles sans t’arrêter…
P.d.C. : Si je fais ça, ce n’est pas non plus pour dire le plus de choses possibles. Je ne l’ai pas conscientisé quand j’ai commencé ce travail, je le faisais déjà comme ça. Dès la fin de mes études aux Beaux-Arts, quand j’ai commencé à faire des spectacles, j’ai tout de suite parlé beaucoup et sans m’arrêter.
Pour pouvoir proposer cette forme d’ode, qui n’est pas du tout une conférence, mais une proposition littéraire et orale, le rythme est important. Si je faisais des pauses, on entrerait dans une autre forme de réception, le public comme moi : on serait plus dans l’observation et moins dans les émotions. Il ne s’agirait plus d’être ensemble dans cette vague, ce fleuve. Le fleuve permet aussi de dire : « Faites-moi confiance. Il n’y a pas besoin de s’arrêter sur chaque chose. Ce que nous faisons est une traversée, et nous allons retomber sur nos pattes. »
C’est une petite prière que je formule silencieusement au début des pièces. C’est aussi pour ça que je suis déjà là pendant l’entrée du public, que j’essaie de mettre en confiance, de sourire, de regarder les gens, de dire bienvenue – pour dire : on va faire ça ensemble.

NIAGARA 3000
Création et interprétation – Pamina de Coulon
Création lumière – Alice Dussart
Création décor – Pamina de Coulon, Alice Dussart
Production, diffusion – Sylvia Courty
Du 18 au 22 novembre au Théâtre Silvia Monfort, Paris
Prochaines dates
17 mars 2026 – Centre Culturel André Malraux, Vandœuvre-lès-Nancy
25 et 26 mars – Lieu Unique, Nantes
14 et 15 avril – Centre Culturel d’Uccle (Belgique)
21 et 22 avril – Théâtre d’Angoulême
24 avril – Le Moulin du Roc, Niort
18 au 20 juin – MAIF Social Club, Paris
MALEDIZIONE
Recherche, écriture, conception et jeu – Pamina de Coulon
Décor – Pamina de Coulon, Alice Dussart
Lumière – Alice Dussart
Production, diffusion – Sylvia Courty
Du 25 au 29 novembre au Théâtre Silvia Monfort, Paris.
Prochaines dates
4 et 5 mars 2026 – Le Pommier, Neuchâtel (Suisse)
18 mars – Centre Culturel André Malraux, Vandœuvre-lès-Nancy
Entretien réalisé le 14 mars 2025, et le 14 novembre 2025 (pour les questions sur MALEDIZIONE)
Voir le site internet de Pamina de Coulon.
Petite bibliographie
de quelques autres auteur·ices autochtones qui m’inspirent et m’aident à penser le monde et dont j’aime me faire le relais :
Robin Wall Kimmerer
Kyle Powys Whyte
Lou Cornum
Zoe Todd
Notre critique de NIAGARA 3000 : La flamboyante débâcle de Pamina de Coulon.
Tous nos articles Théâtre et Performance.