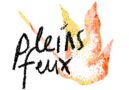En ce moment au Théâtre 13 – Bibliothèque, d’étranges créatures poilues investissent le plateau : Pour que l’année soit bonne et la terre fertile, dernière création du collectif Mind the gap, prend comme point de départ un costume de monstre chevelu, pour déployer une proposition hybride autour de la vie de collectif et de la création artistique.
Sur l’affiche, on distingue un étrange chœur : des créatures hirsutes, au poil long, sans visage apparent. Mais quand Pour que l’année soit bonne et la terre fertile débute, nulle trace d’elles. Les cinq comédiens du collectif Mind The Gap, en habits de ville et les mines déconfites, se présentent face à nous pour annoncer : « Il n’y aura pas de spectacle ce soir. Le spectacle n’existe pas. » S’ensuit alors une longue prise de parole du collectif tentant de nous expliquer comment ils et elles en sont arrivées là.
Le costume et l’échec
Créé par la costumière-plasticienne Karine Marques Ferreira, ce costume de monstre poilu provoque immédiatement une fascination pour le collectif, et l’envie de lui inventer sa manière propre d’exister.
Ce discours parcourt les espoirs, les difficultés et les doutes de la création théâtrale contemporaine. Il met en scène, avec humour, la vie d’un collectif aux relations fluctuantes, les blocages artistiques et autres pannes d’inspiration, les contraintes techniques et le bilan carbone désastreux, et la peur autant d’échouer que de refaire ce qui a déjà été fait. Les comédien·nes sont touchant·es dans l’expression ennuyée de leur déconvenue, et drôles quand ils énumèrent les différentes excuses ou mensonges auxquelles ils ont pensé pour justifier l’annulation du spectacle : accident, décès… Mais il faut le reconnaître, c’est bien un blocage personnel et artistique qui a saisi les membres du collectif, dépassés en vérité par l’ampleur de leur point de départ, centre névralgique du projet tout entier : le costume.
Créé par la costumière-plasticienne Karine Marques Ferreira pour une Fashion Week, ce costume de monstre poilu provoque immédiatement une fascination pour le collectif Mind the Gap, et l’envie de s’en approcher et de s’en emparer, d’inventer à ce monstre sa manière propre d’exister, de se mouvoir. Ils et elles nous racontent, nous décrivent ce costume, créant ainsi une attente. Le discours introductif, dont on comprend qu’il dépasse le simple cadre d’une introduction et devient une grande partie du spectacle, joue totalement de cette attente, tout comme le « paratexte » du spectacle : les affiches bien sûr, mais aussi de fausses critiques citées sur le site internet du théâtre. Mais sans céder à notre impatience, le groupe continue de nous partager son cheminement et ses désirs.

Ce costume, cette créature, c’est pour eux l’occasion de muer, se transformer, décaler le regard. Ancrant leur intention dans cette crise de la sensibilité au vivant si bien décrite par Baptiste Morizot ou Donna Haraway, l’enjeu est tout trouvé : s’hybrider, ou s’ensauvager, pour « faire groupe autrement », une meute, une famille. Mais une fois les costumes face à elleux, ceux-ci se révèlent, dans leur matérialité et leur étrangeté, trop gros, trop imposants, trop énormes pour les comédien·nes. « Beaux, mais impraticables », encombrants, à l’entretien exigeant, et finalement source d’angoisse – provoquant au final l’échec de la tentative de spectacle.
Rituel poilu
Petit à petit, cette séquence un poil trop longue où l’on tente de démêler les discours est perturbée par le surgissement intempestif d’une pilosité envahissante…
Et pourtant, petit à petit, cette séquence un poil trop longue où l’on tente de démêler les discours est perturbée par le surgissement intempestif d’une pilosité envahissante… Ce qui commence par une interminable mèche de cheveux découverte dans un chignon, colonise peu à peu les acteur·ices, le plateau, et même le langage, au gré d’expressions imagées placées ça et là (« on tourne en boucle », « à un cheveu »…). D’abord imperturbables, les comédien·nes se laissent finalement envahir par cette chevelure foisonnante, disparaissant l’un·e après l’autre sans explication. Malgré tous leurs aveux d’échec, le renversement s’opère, et les créatures apparaissent enfin. Elles sont là face à nous, dans cette image d’altérité et d’étrangeté promise. Quelque part entre le yak d’Asie centrale et les divinités d’un folklore imaginaire, inspirés d’anciens rituels européens, elles entament un ballet à même de chasser les mauvais esprits, et d’amener les bonnes récoltes : « pour que l’année soit bonne et la terre fertile… ».
Sur une mélodie entêtante qui mêle rythmique contemporaine electro, et instruments traditionnels – tambours, grelots, cloches – qui évoquent une dimension sacrée, rituelle, les créatures se secouent les poils, et l’on entrevoit enfin cette hybridation humain-animale que le collectif appelait de ses vœux. Les comédien·nes ayant assumé de n’être pas des danseurs, l’ensemble renvoie une image à l’entre-deux de la performance d’art contemporain et du spectacle de kermesse d’école, dans une naïveté du geste qui rappelle le travail de Philippe Quesne. Du ballet à la transe, le collectif Mind the Gap tient le mouvement jusqu’au bout du bout, jusqu’à l’épuisement : et par empathie on a l’impression d’être soi-même en sueur.

Heurs et malheurs du méta-théâtre
Ainsi le collectif Mind the Gap crée-t-il un spectacle aussi hybride que son objet, où l’esthétique anti-théâtrale se transforme en une proposition scénique audacieuse et foisonnante.
Ainsi le collectif Mind the Gap créé-t-il un spectacle aussi hybride que son objet, où l’esthétique anti-théâtrale se transforme en une proposition scénique audacieuse et foisonnante. On regrette néanmoins que le discours méta-théâtral, celui de l’œuvre qui se prend elle-même pour objet, occupe autant de place. Celui-ci occupe en effet la moitié, sinon plus, de la pièce, et nous décrit avec passion le spectacle imaginé… à défaut de nous le montrer, s’auto-analysant dans ce qui sonne comme une redite de la note d’intention. Au final le revers de la médaille de cette hybridité est l’image d’un spectacle bancal, qui certes annonce et assume son propre échec, mais le fait en créant des attentes pour finalement nous montrer tout de même quelque chose qui ne répond que partiellement à celles-ci.
Plutôt que de faire confiance à ce qui pourrait advenir de puissant ou de poétique au plateau, de se risquer à tenter quelque chose quitte à le rater, Pour que l’année soit bonne et la terre fertile nous laisse avec une impression d’inabouti et de déception (là où un Philippe Quesne justement, assume par exemple jusqu’au bout de faire un spectacle avec des acteur·ices en costumes de taupes, sans parole). Et même quand les créatures font enfin leur apparition au plateau, jamais l’humain ne s’efface complètement : les comédien·nes continuent de s’exprimer avec leur voix normale et de s’adresser les un·es aux autres dans la continuité du discours méta-théâtral de la première moitié, anesthésiant l’étrangeté que le costume avait fait advenir.
Reste cette confession d’acteur·ices sur la difficulté à créer aujourd’hui, touchante, et qui fait écho à une autre œuvre, autre tentative d’un collectif qui se joue, hasard du calendrier, en même temps : After Show, du collectif L’Avantage du doute. Peut-être alors faut-il voir dans ces dramaturgies en écho, comme dans la présence de plus en plus marquée de propositions méta-théâtrales en général sur les scènes contemporaines, le symptôme d’un théâtre contemporain en crise qui se cherche et qui s’interroge.
Pour que l’année soit bonne et la terre fertile
Création et jeu – Solenn Louër, Julia De Reyke, Anthony Lozano, Coline Pilet, Thomas Cabel
Dramaturgie – Léa Tarral
Costumes – Karine Marques Ferreira
Scénographie – Clémence Delille
Création son – Estelle Lembert
Création lumières – Théo Tisseuil
Regard chorégraphique – Flora Pilet
Couture costumes – Clara Signoud, Flore Chrétien , Melody Desbrueres, Solenn Louër
Régie générale – Paul Cabel
Administration, production et diffusion – Anémone Production – Margot Guillerm, Adèle Tourte
Au Théâtre 13 – Bibliothèque, du 26 novembre au 6 décembre 2024